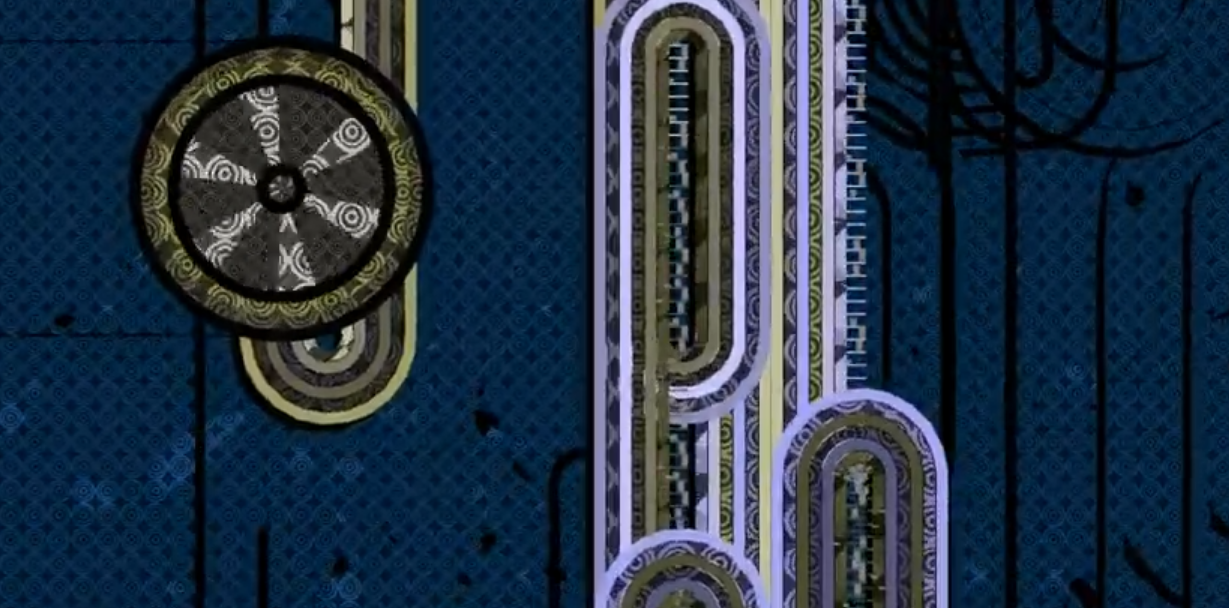Le capital : une brève mise à jour
A lire : « Le capital une brève mise à jour » – lien : https://www.tempscritiques.net/spip.php?article550 Ce texte constitue un nouveau bilan de notre parcours collectif quant à l’analyse du capital. Il actualise celui que nous avions produit dans la brochure Après la révolution du capital (2018). Que les choses soient claires, malgré nos références encore nombreuses au Marx anticipant certains développements du capital, qui nous paraissent plus que jamais d’actualité, placer Temps critiques dans la continuité des anciens débats internes aux marxismes n’est pas exact. Certes rompre avec toute la problématique de la « valeur » nécessite encore d’en parler et de dire pourquoi. D’où la récurrence toujours présente de notre emploi du terme « d’évanescence de la valeur ».
Du point de vue des sources théoriques, des auteurs comme Polanyi, Braudel, Keynes, le Castoriadis de la fin de la revue Socialisme ou Barbarie, la revue Invariance à partir de sa série II, sont aussi importants pour nous dans cette optique de saisie du rapport social capitaliste. Nous avons aussi précisé en 2019 Pourquoi le communisme n’est-il plus qu’une référence historique pour les membres de Temps critiques ? (brochure de mai 2019), tout en montrant, quasiment dans le même temps, par notre intervention et action dans le mouvement des Gilets jaunes, que pour nous, la rupture du fil rouge des luttes de classes, ne signifiait pas la fin des antagonismes sociaux et des révoltes.
Disponible aussi en brochure à imprimer sur ce lien : https://www.tempscritiques.net/IMG/pdf/le_capital_une_breve_mise_a_jour_livret_.pdf