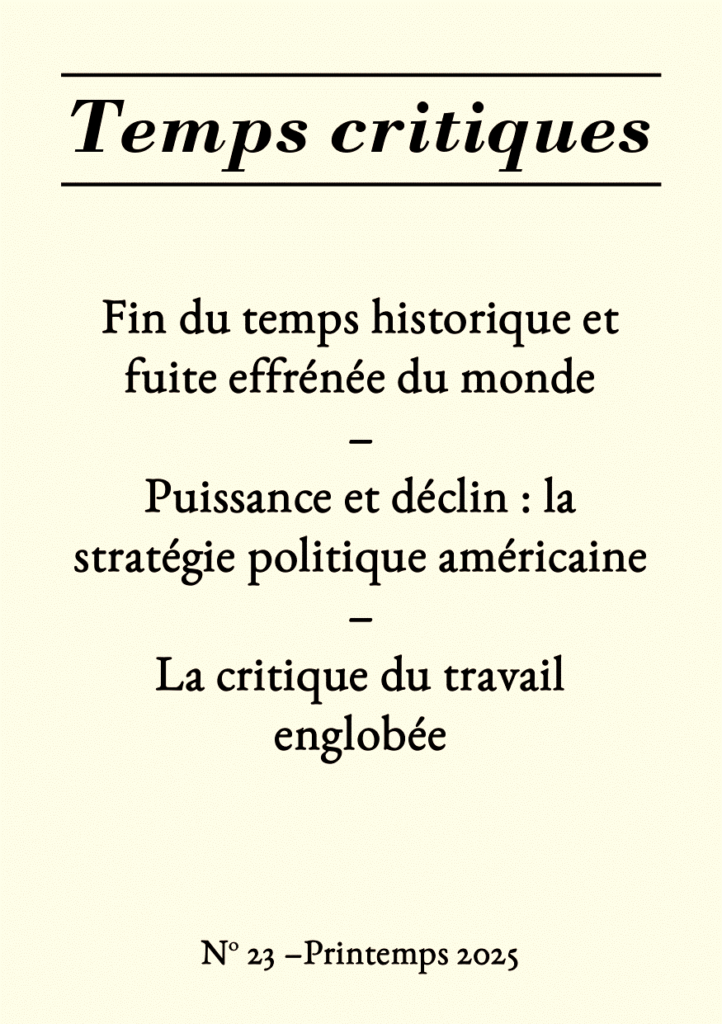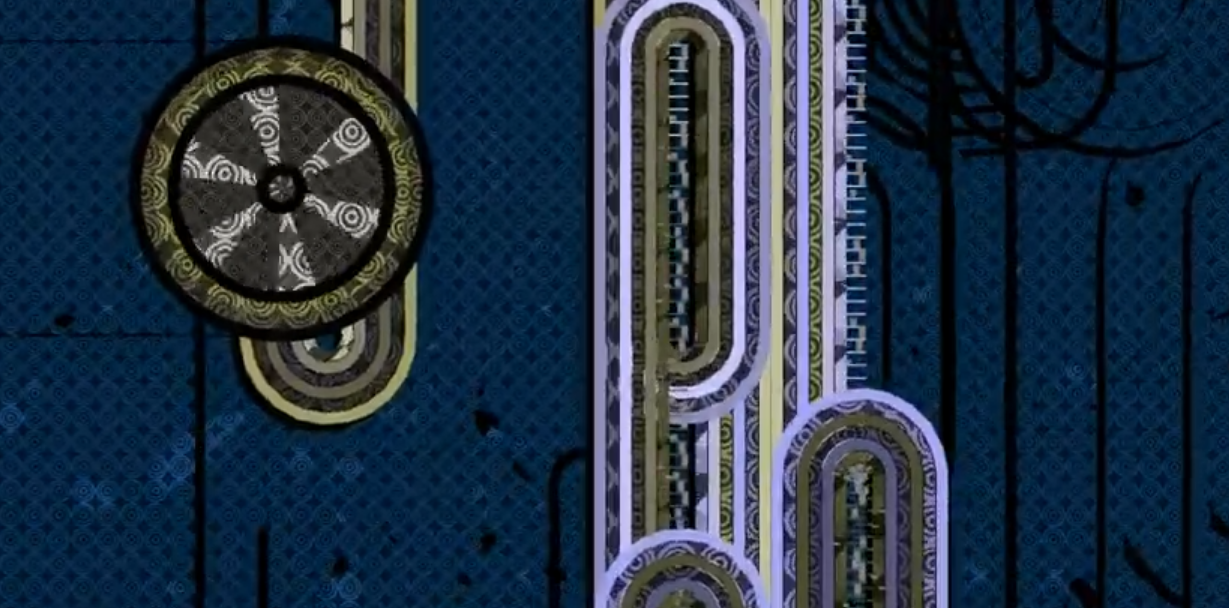L’indéterminé du 10 septembre
Suite à l’appel à « tout bloquer » le 10 septembre 2025, nous avons proposé un texte disponible sur ce même blog (https://blog.tempscritiques.net/archives/5244) que nous complétons avec la vidéo ci-dessus.
Au passage, vous trouverez sur Instagram une autre vidéo à ce sujet inaugurant sur la plateforme la présence de Temps critiques : https://www.instagram.com/tempscritiques