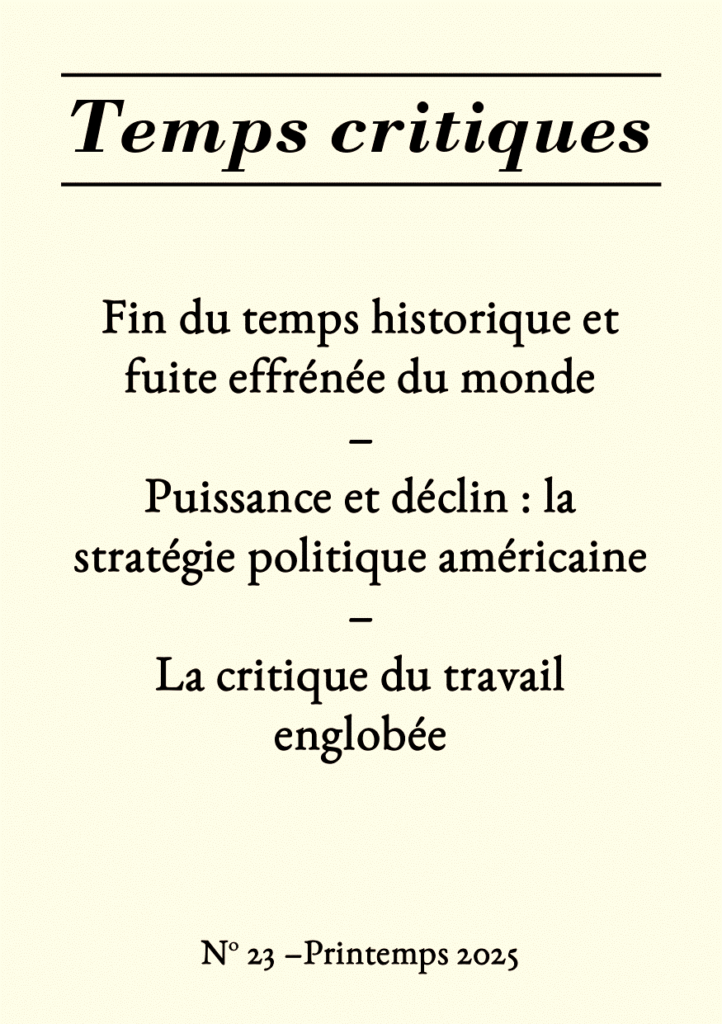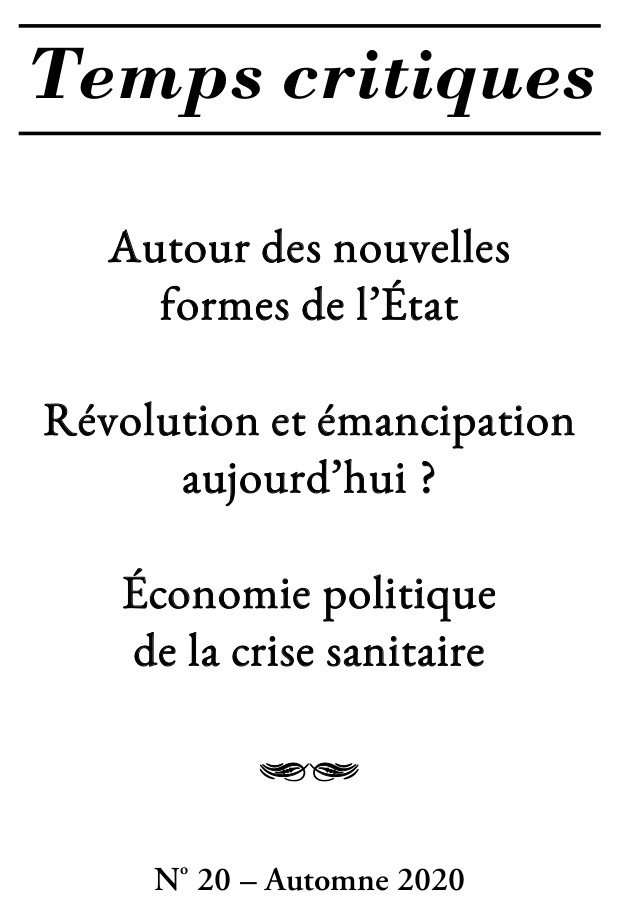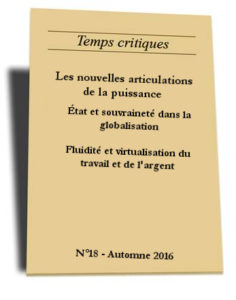L’actualisme de la guerre
Dans la continuité de la sortie du livre de J.Wajnsztejn (L’achèvement du temps historique), mais aussi du n°23 de la revue Temps critiques vous trouverez ici en lien, des éléments de réponses à des questions qui nous sont parvenues.
Dialectique du temps historique et société capitalisée
Certains individus, intéressés par les écrits de Temps critiques et aussi d’autres lecteurs plus assidus, peuvent nous poser une question sur l’actualité des guerres qui serait le signe d’un retour aux guerres entre nationalismes et donc une réfutation, de fait, de la notion « d’achèvement du temps historique » développée dans le livre de J.Wajnsztejn.
Aveuglé par une approche immédiatiste, l’argument s’apparenterait à ceci : puisqu’au XIXe et au XXe siècle, les guerres entre puissances nationales manifestaient typiquement un temps historique, celui des États-nations et de leurs conflits territoriaux et de valeur (dévalorisation/valorisation), alors pourquoi cette historicité serait-elle rendue caduque par la fin de la « Grande politique » (Tronti) et l’achèvement du temps historique (J.Wajnsztejn) ?
Préalable notionnel (pour tenter d’éviter quelques méprises)
L’achèvement du temps historique (J.Wajnsztejn) ou la fin de l’histoire et la sortie de l’histoire (H.Lefebvre), ne signifient pas que nous serions entrés dans une époque où l’histoire n’existe plus ; une époque de paix universelle ou au contraire de guerre perpétuelle ou encore de mondialisation définitive (soit heureuse, soit malheureuse, selon telle ou telle idéologie) ou encore une stagnation sans fin, une répétition dans l’immobilisme où tout serait devenu équivalent, ou encore penser que l’homme (l’espèce humaine) serait frappé par son obsolescence (G.Anders), etc. Non.
L’histoire n’est pas close, n’est pas terminée, elle continue.
C’est du temps historique dont il s’agit, ce qui est différent.
Pour le dire brièvement et abstraitement : c’est de l’histoire comme mouvement dialectique dont il s’agit ; ce qui ne signifie pas réaffirmer ou redéfinir un « sens de l’histoire ».
Parlons-en
1- Partons de deux citations :
« Toutefois, le regain souverainiste qui se manifeste un peu partout, avec aussi la guerre russe en Ukraine, montre qu’aucune tendance n’est réalisée.Comme la reterritorialisation tendancielle actuelle des activités économiques, le resurgissement des questions de territoire, de frontières et des identités nationales ou régionales agit comme une piqûre de rappel contre la virtualisation du monde, de la même façon que la crise de 2008 était une piqûre de rappel pour cadrer les débordements de la fictivisation du capital.
Il est d’ailleurs curieux, à ce point, de rapprocher la thèse de la « fin de l’Histoire » d’une autre conviction qui paraît à première vue radicalement opposée, celle de l’« accélération de l’Histoire ». En effet, les deux thèses, d’apparence contradictoire, se rejoignent d’abord superficiellement dans l’illusion d’un temps linéaire dominant et plus profondément dans leur indifférence à la notion même de temporalité. » (souligné par J.Guigou)
Jacques Wajnsztejn, L’achèvement du temps historique,L’Harmattan, p.114-115.
En écho, notons un paragraphe de La Fin de l’histoire d’Henri Lefebvre, Minuit, 1970, p.223.
Le début rappelle que « Seules la lutte à mort librement décidée, la lutte des classes et la guerre révolutionnaire ont produit l’histoire. Sur ce point, Marx s’accorde avec Hegel ». Lefebvre poursuit à propos de l’hypothèse d’une « sortie de l’histoire », dans laquelle « l’histoire ne suffit plus à motiver les actes, à fournir les objectifs, à orienter les stratégies » [qui seraient pour Lefebvre les indices du « post-historique » J.Guigou] :
« Quoiqu’il en soit, il semble impossible de présenter la période incriminée (la sortie de l’histoire) comme une simple fin des remous historiques; arrêt du mouvement et par conséquent des violences, entrée dans la stagnation sans fin. On pourrait imaginer une perpétuelle violence, des évènements sans trêve, mais sans que les changements s’enchaînent à la manière historique ». (Souligné par J.Guigou).
Des changements qui se sont enchaînés à la manière historique, comme dans le passage de l’État de sa forme empire à sa forme nation (le mouvement des nationalités), le mouvement de décolonisation ou encore le cycle révolution/contre-révolution. C’est ce cours historique qui liait ensemble crise, guerre et révolution qui a failli.
2-Des guerres perpétuelles, mais sans portée historique majeure
Guerre en Ukraine, guerre à Gaza, guerre israélo-iranienne correspondent bien à cette « perpétuelle violence… sans que des changements s’enchaînent à la manière historique » ainsi que l’analyse H.Lefebvre.
Autrement dit, ces guerres sont bien celles de la révolution du capital où les puissances et les intérêts qui s’affrontent peuvent certes agir pour une conquête ou une défense de territoire, mais elles expriment surtout une stratégie d’hégémonie sur des fractions nouvelles de capital et leur puissant pouvoir technologique.
Par exemple les affrontements sur les ressources naturelles pour exercer si ce n’est un monopole, du moins un contrôle de l’exploitation des terres rares ou encore les conflits pour l’accès à l’eau.
On pourrait rapprocher ce que dit Lefebvre sur la période de la fin de l’histoire, avec ce que nous nommons « la fin du cycle historique des révolutions ». Un cycle où c’était, avant tout autre intérêt (économique, idéologique, religieux, etc.), la politique qui conduisait le cours du monde et cherchait à l’orienter selon un but collectif supérieur.
Or, ce cycle historique des révolutions a coïncidé dans le monde occidental et le mouvement de la valeur (l’accumulation) avec le cycle des luttes de classe : révolution bourgeoise d’abord, révolution prolétarienne ensuite. L’autonomie de la politique s’y manifestait en ce qu’elle orientait les rapports de force et les enjeux des luttes. Les contradictions politiques de classe traversaient les nations et leurs États : liberté et égalité des peuples versus intérêts de la classe des propriétaires dans la révolution française ; internationalisme prolétarien versus « union sacrée » pour la patrie en 1914. Rappelons que « l’union sacrée » avait été rejetée en 1915 par les internationalistes à la Conférence de Zimmerwald.
Aujourd’hui, dans la guerre en Ukraine, où est l’autonomie de la politique chez les Russes comme chez les Ukrainiens ? D’un côté comme de l’autre, le cours de la guerre et de la paix est subordonné à la totalité des deux sociétés dans lesquelles économie, technologie, industrie, commerce, contrôle de la population, etc., ne forment qu’une seule entité matérielle. Donné comme exemplaire par les dirigeants et les médias européens, le patriotisme ukrainien est très relatif, il n’est pas élevé. D’abord, de très nombreux ukrainiens sont exilés : près de 7 millions selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l’ONU ; ensuite le refus de l’embrigadement dans l’armée et la désertion concernent aussi des milliers de jeunes ukrainiens. Se manifeste aussi une opposition à la guerre de la part des veuves de soldats et de leurs familles. Il y a bien une subordination de la population à la politique de guerre qui produit en quelque sorte un patriotisme de la survie.
Si une temporalité par rapport à la guerre se dessine plus ou moins (avant, pendant, après la guerre), elle ne contient pas d’historicité, pas de dialectique. Seules dominent l’actualité de la guerre et les tractations diplomatiques mondiales pour la paix : un seul moment déhistoricisé où guerre et paix sont des modalités pratiques, certes différentes (pour les vivants et les morts !), mais qui se situent dans le même monde, c’est-à-dire le monde des conflictualités incessantes, mais sans discontinuité historique profonde.
Par exemple,Poutine rejoue l’empire ;l’autorité palestinienne rejoue en farce (sous regard israélien) l’État-nation. Le poids des milices d’un côté (Hamas et Hezbollah), du néo-colonialisme armé de l’autre, sont eux déjà dans l’au-delà de l’histoire. Quant à Israël, à rebours de sa politique néocoloniale, il rejoue la figure de l’État-nation (le citoyen-soldat) à l’époque de la crise des États-nations. D’où aussi le fait de pouvoir jouer sans vergogne l’idée du seul état démocratique de la région au milieu de la barbarie ambiante.
Un monde « qui a changé de face » avec la révolution du capital, mais qui était déjà en gestation après le fiasco des opérations de police en Irak, comme nous le soulignions dans la brochure : « L’unité guerre-paix dans le processus de totalisation du capital » (2003).
Eric Hobsbawm le disait autrement dans Nation et nationalisme depuis 1780: « Même si personne ne peut nier l’impact croissant et parfois spectaculaire de la politique nationaliste ou ethnique, ce phénomène est aujourd’hui fonctionnellement différent du “nationalisme et des “nations” du XXe et XXe siècle sous un aspect essentiel : il n’est plus un vecteur majeur du développement historique » (op.cit.Gallimard, p.209-210, 1992).
On peut en dire autant pour les conflits de l’État israélien avec le Hamas, le Hezbollah et le régime iranien. L’histoire s’y absente, puisque depuis la création de l’État d’Israël, la guerre n’a pas cessé avec des phases de hautes et de basses intensités. Là aussi la politique est englobée dans toutes les déterminations de chacune de ces sociétés : religieuses, économiques, culturelles, technologiques, messianiques.
Précisons.
La création de l’État d’Israël est encore située dans la Grande politique pour au moins deux raisons, l’une externe, l’autre interne à l’histoire de ce peuple :
– une raison externe: l’État sous sa forme nation. En 1947, l’État-nation est dominant dans le monde. C’est d’ailleurs une instance internationale, L’Organisation des Nations Unies, qui a instituée un territoire qui l’année suivante va se nommer Israël. L’État d’Israël s’inscrit ainsi dans la Grande histoire des États-nations dont la matrice politique est l’œuvre de la révolution française. Nous sommes donc bien toujours dans le temps historique, celui des révolutions et des contre-révolutions, etc.
– une raison interne : une force, un mouvement politique, idéologique, culturel, religieux : le sionisme, s’institutionnalise dans une forme : l’État d’Israël. Ce processus dialectique, donc historique, d’une force qui devient une forme est un processus profondément historique. René Lourau1 l’a théorisé à partir du modèle de C.Castoriadis2 : institué, instituant, institutionnalisation. En Israël, cette dynamique (politique, militaire, sociale) a fonctionné plusieurs décennies. Est-ce toujours le cas ? Sinon, à quel moment s’est opéré l’épuisement et le passage à autre chose. On pourrait répondre à partir des échecs successifs des multiples tentatives de paix sous la forme de deux États. Toutes ont échoué.
Ces échecs ont conduit à une sortie de « La Grande politique ».
Déjà avant le 7 octobre 2023, la sortie du temps historique était en cours. Elle s’est accélérée avec cette attaque. La guerre des puissances rend manifeste et sans retour la guerre de défense de l’existant qui était présente depuis la fondation d’Israël.
Éloignées, mais présentes dès avant la création de l’État d’Israël, les utopies de coexistence pacifique ont disparu de l’horizon politique au Moyen-Orient. Le pouvoir stratégique du niveau I du capital avance alors ses imageries : une « Riviera à Gaza » devenant plate-forme des flux financiers et des spéculations immobilières mondiales.
Au Moyen-Orient comme ailleurs, nous sommes bien entrés dans l’achèvement du temps historique. Les dimensions nationales/nationalistes sont certes présentes, mais elles n’ont pas d’orientation strictement politique. Plutôt idéologiques, elles sont englobées dans une sorte d’état de guerre constitutif qui tient lieu de politique, d’économie, de culture, de mode de vie, etc. ; un état qui tend — tragiquement — à « sortir de l’histoire ». À cet égard, depuis plusieurs années, la situation en Iran avec des révoltes récurrentes réintroduit de l’indéterminé, de la dialectique des forces, bref de l’historicité, que le jeu surplombant des puissances étatiques vient perturber. Ainsi aujourd’hui, bien malin qui dira l’effet des bombardements israéliens et américains sur les forces sociales en Iran.
3- Conflictualités plus nombreuses et achèvement du temps historique
Les violences diffuses, mais aussi précises et généralisées ainsi que les conflits s’accroissent depuis des décennies. Les observatoires des conflits le rapportent :
« Il n’y jamais eu autant de conflits depuis la Seconde Guerre mondiale »
Tribune de Genève, 19:11/24.
Cette réalité entre-t-elle en contradiction avec la thèse d’un achèvement du temps historique ? Nous ne le pensons pas. Pourquoi ?
Dans le paragraphe précédent, nous avons déjà montré que les guerres en cours relèvent le plus souvent d’un englobement de la politique dans le sociétal, l’économique, l’ethnicité et le nihilisme, de sorte que l’historicité tend à être effacée dans les affrontements de puissances. Ainsi, dans l’exemple du conflit israélo-palestinien, la mémoire de l’évènement historique que fut la création de l’État d’Israël tend à s’effacer au profit de l’image d’une toute-puissance d’autant plus prégnante que la défaite des nationalismes arabes « progressistes » est encore ressentie.
Un achèvement du temps historique qui s’accompagne d’une part de la disparition des événements historiques majeurs, recouverts par les répétitions et les parodies des politiques interventionnistes (cf. L’échec de la France en Afrique) et d’autre part de l’abandon d’une vision dialectique des conflits au profit d’un (impossible) consensus identitaire. Deux caractères majeurs de la « sortie de l’histoire » ou encore de l’achèvement du temps historique.
Mais ils interviennent également dans ces états permanents de violence et de guerre, des déterminations qui relèvent de la nature des guerres elles-mêmes. Notamment le fait que les forces en guerre ne peuvent pas désigner clairement leur ennemi. Comme dans les guerres de partisans (cf. C.Schmitt, Théorie du partisan, Flammarion, 2009), les forces ennemies ne sont plus seulement composées d’armées régulières d’un État, mais s’y agglomèrent des groupes armés divers qui peuvent d’ailleurs poursuivre des objectifs propres, non complémentaires avec les forces étatiques.C’est alors la qualité même d’ennemi qui est déniée avec comme conséquence la criminalisation d’États qui seront qualifiés de voyous et la criminalisation des groupes qualifiés, souvent à raison, de terroristes.
Le Groupe Wagner en Russie est emblématique de ce type d’alliance conflictuelle qui, au cours des affrontements a conduit à un conflit intérieur dans la guerre extérieure (cf. en juin 2023, la tentative d’attaque de Moscou par les troupes de Prigojine). Les Groupes Hamas et Hezbollah relèvent des mêmes tensions internes dans la guerre interétatique Israël-Iran.
Ces (relatives) indéterminations dans la désignation de l’ennemi constituent un indicateur de l’époque de l’achèvement du temps historique. Un fait qui signe également la fin de l’autonomie de la politique.
Nous retrouvons là un des indicateurs qui pour H.Lefebvre marque la sortie de l’histoire, à savoir une situation « où l’histoire ne suffit plus à motiver les actes, à fournir les objectifs, à orienter les stratégies ».
Autrement dit, la guerre n’est plus la continuation de la politique avec d’autres moyens selon la formule de Clausewitz, mais pourrait-on dire, les guerres et les conflictualités généralisées n’ayant plus de contenu politique autonome, elles tendent à devenir un état constitutif des sociétés qui ne sont encore que très partiellement capitalisées. D’où leur caractère répétitif … et insignifiant, sauf pour les populations qui les subissent.
Partiellement capitalisées, car à l’exception d’Israël, la plupart de ces conflits ne concernent que des régions où le capital circule, la capitalisation peut y exister marginalement sous forme presque exclusivement rentière certes, mais en dehors de la constitution d’une société capitalisée ; c’est d’ailleurs pour cela, que parfois, la « société civile » s’y manifeste à nouveau, que ce soit en Iran, en Égypte où elle existait déjà dans les années 1950-1970 ou parce qu’elle n’a encore jamais existé comme en Algérie, en Tunisie ou au Soudan où se rejoue dans d’autres conditions, la révolution française en termes de liberté, égalité et fraternité.
4- La société capitalisée comme signe de l’achèvement du temps historique
ou plus justement, on trouve dans la société capitalisée de nombreux signes de l’achèvement du temps historique.
Énumérons-en les principaux :
- Positivité généralisée (déni et rejet du négatif assimilé à la perte et au contre temps ; aliénation effacée, émancipation exaltée, etc.)
- Équivalence et indifférenciation des valeurs ; mise en avant des déterminations naturelles posée contradictoirement comme essence et production culturelle car tout peut exister côte à côte quand on quitte l’argumentation dialectique et le raisonnement en termes de contradiction (genrisme, trans, etc.) …pour finir en déconstruction.
- Donc pourquoi lutter ? Pourquoi agir ? Pour qui agir ? Moyens et but sont confondus : l’activité réduite au revenu ou encore l’émeute prise pour l’insurrection ;
- Nihilisme (fascination violence/destruction version no futur ou version Black Bloc);
- La temporalité anthropologique (passé, présent, futur) disparaît, recouverte par l’actualisme ;
- Omnipotence des technologies et des biotechnologies qui deviennent seconde nature (IA, transhumanisme, fabrique de l’humain, etc.)
- Virtualisation de l’économie : le capital fictif gère les rapports sociaux réduits à des intersubjectivités sans sujet ;
- L’État sous sa forme réseau et l’institution résorbée, donc le déclin de l’État dans sa forme nation. ;
- L’évènement Gilets jaunes comme refus de l’achèvement du temps historique puisque ce dernier tend à neutraliser, à désamorcer le surgissement d’événements au sens fort tout en transformant n’importe quel fait en un événement ;
- Les guerres sont déhistoricisées ; leur potentielle négativité est convertie en « opération de police » en Irak ou en Lybie, en « opération militaire spéciale » pour la Russie en Ukraine ; en « opération déluge d’Al Aqsa » (attaque islamiste du 7 octobre) ou encore en « Chariots de Gédéon » pour Israël à Gaza et opération « Rising Lion » contre les installations nucléaires iraniennes.
Autrement dit, une tentative pour éliminer la datation dans la mémoire collective (la dimension anthropologique du temps historique) et la remplacer par une formule sans signifiant autre que métaphorique. Elles sont aussi désidéologisées par rapport à l’époque de la Guerre froide comme le montre la politique de Trump qui veut faire rembourser les dépenses américaines pour l’OTAN et la défense du monde occidental.
5- Les souverainismes contemporains ne sont pas analogues aux nationalismes des XIXe et XXe siècles.
Ils ne sont pas ancrés dans l’État-nation, mais relèvent d’une volonté de définir et d’exercer une puissance politique indépendante aussi bien à travers l’État national que via les réseaux et l’État réseau.
Une puissance politique qui s’appuie sur les représentations réelles et symboliques des couches et des milieux sociaux « invisibles » car dominés par les castes et les réseaux aussi bien du niveau I que du niveau II (l’aristocratie médiatique et économique du niveauII).
Car sous les termes fourre-tout de « populismes », « d’isolationnisme/protectionnisme » ou « d’anti-fédéralisme », les souverainismes exercent leur puissance aussi bien dans le capital national que dans le capital globalisé. Par exemple, aux USA, les mesures de l’administration Trump pour réduire certains secteurs de la bureaucratie fédérale qui relèvent, a priori, du niveau II, peuvent être interprétées comme un souverainisme de niveau I, car elles visent, indirectement, à renforcer d’autres secteurs stratégiques, décisifs dans la concurrence avec la Chine (armement, technologies, IA, etc.).
Une des différences notables entre les souverainistes contemporains et les nationalismes des XIXe et XXe siècles concerne la valorisation par conquête territoriale : les colonisations.
Dans les colonisations historiques, l’accumulation et la valorisation des capitaux nationaux se réalisaient à la fois dans le territoire national et dans les territoires conquis. Une double appropriation : interne, avec l’exploitation de la force de travail ouvrière et externe avec l’exploitation de population surtout paysanne (produits agricoles et commerce des matières premières).
Alors qu’aujourd’hui, les appropriations ont tendance a être déterritorialisées et les politiques de reterritorialisation ne représentent qu’une contre-tendance partielle et fragile. Les économies de plates-formes sont globalisées et elles opèrent à distance. Elles peuvent rapidement déplacer leurs entrepôts d’un pays à un autre ; de sorte que leurs interventions ne cherchent pas une valorisation des ressources locales : les emplois directement créés sont faibles, car elles sont puissamment robotisées. Les forces souverainistes s’y opposent, mais sans résultats politiques réels.
Autre exemple : les annexions de régions frontalières par le régime russe ne relèvent pas de l’ancien modèle colonial appropriationniste. Elles entrent dans une logique politique de constitution d’une zone de protection avancée par rapport à des puissances hostiles ; des bases avancées d’un État-empire où elles sont englobées.
Les anciennes dynamiques colonisatrices étaient d’abord appropriatrices, les actuels souverainismes sont une sorte de néo-conservatisme plus défensif qu’offensif.
Si on replace cela à un niveau plus général développé dans le livre de Jacques Wajnsztejn, on peut y voir une résistance désespérée à l’accélération du temps capitalisé et à son nouveau rapport à l’espace. Une résistance qui n’est évidemment pas la nôtre, mais qui, au moins, ne nous place dans aucun camp, même pas celui de la paix.
Jacques Guigou
1er juillet 2025
- René Lourau, L’instituant contre l’institué, Anthropos, 1969. [↩]
- Cornelius Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, Seuil, 1975. [↩]