Crise de l’État-nation et politique des « zones d’influence »
Nous publions le numéro #32 d’Interventions intitulé Crise de l’État-nation et politique des « zones d’influence » immédiatement disponible à la lecture et impression sur ce lien.
Nous publions le numéro #32 d’Interventions intitulé Crise de l’État-nation et politique des « zones d’influence » immédiatement disponible à la lecture et impression sur ce lien.
Cet échange interne à la revue fait suite à nos récentes interventions sur la situation aux États-Unis.
Le 17.07.2025
Dans mon texte et en général, j’ai mis en garde contre la tendance des Américains à ressasser les valeurs éternelles des pères fondateurs, etc., mais après avoir vu les rassemblements du 14 juin, je me demande s’il n’y a pas malgré tout une sorte de parenté avec ce qu’on a pu constater en France, avec la mémoire de la Révolution française. En effet, partout ou presque, c’est le refus de la tyrannie et de l’arbitraire qui a été mis en avant le 14. Une pancarte qui m’a particulièrement plu : « Eux veulent l’Allemagne de 1939, donnons-leur plutôt la France de 1789 ! »
Larry
Le 20.07.2025
Bonjour,
L’analogie sur la référence à la Révolution française entre les manifestations du No Kings Day aux USA et l’évènement Gilets jaunes n’a pas vraiment de réalité politique.
Pour les GJ, nous l’avons mis en évidence dans notre texte « L’envie de Révolution française des Gilets jaunes », même dans les moments les plus anti-autoritaires du mouvement, ceux où dans les manifestations de décembre 2018, le mot d’ordre de destitution de Macron s’est exprimé le plus fortement, il n’est pas équivalent au No Kings de certains manifestants du 14 juin aux USA contre le pouvoir fédéral.
En France, c’était le refus d’un ordre jugé injuste, méprisant (« les gueux ») et insensible aux aspirations du peuple. On se souvient des appels des groupes Constituants à fonder une nouvelle république ou encore à l’instauration du RIC = Référendum d’incitative populaire, pour trancher les grandes questions politiques. C’est un régime politique et économique qui doit être abattu, pas une alternance politique.
Aux USA, c’est davantage des mesures politiques jugées autoritaires et discriminantes qui sont visées. Ainsi, l’expression plusieurs fois entendue, « aujourd’hui on s’est compté, ça fait du bien », c’est-à dire on s’est rassuré sur notre force politique ; sous-entendu à la prochaine élection (les miterm dans un an et demi, puis la présidentielle de 28) nous aurons la majorité démocrate pour supprimer ces mesures politiques et économiques.
Le slogan « Eux veulent l’Allemagne de 1939, donnons-leur la France de 1789 » exprime davantage des imageries historiques qui n’ont pas de prise sur les réalités politiques d’aujourd’hui aux USA.
Elles relèvent d’un antifascisme simpliste et creux pour la référence à l’Allemagne de 39 appliquée à la politique de la nouvelle administration américaine et d’une certaine méconnaissance de la révolution française. Le régime de la Terreur a été despotique et Robespierre a été attaqué puis renversé à l’Assemblée aux cris de « mort au tyran », lui qui s’inspirait tant des héros tyrannicides de l’antiquité.
Car cette opposition de deux périodes historiques qui n’ont quasiment rien en commun, ne peut qu’entraîner des confusions et des méprises pour le devenir même des luttes et les aspirations qui se sont manifestées le 14 juin. Le mouvement MAGA, n’est ni un fascisme et encore moins un nazisme.
L’antiautoritarisme qui semblait représenter un dénominateur commun des manifestants du 14 juin est resté soit dans une opposition simple, sans contenu politique autre que l’action contre, soit dans une sorte d’élan pré-électoral.
Il est ici à remarquer que les dimensions de lutte pour l’indépendance des États américains contre le royaume anglais, des luttes qui sont au centre de la révolution américaine, ne sont pas évoquées.
Il est vrai que la « glorieuse révolution anglaise », plus d’un siècle avant la française, avait décapitée un roi (1649). Mais peut-être aussi est-ce là un des effets de ce que Larry appelle « la tendance des Américains à ressasser les valeurs des père fondateurs »…
Ce sont bien sûr, des hypothèses d’interprétation de phénomènes très fluctuants et intermittents, loin d’être fixés.
JG
Le 24.07.2025
Bonjour,
Je souscris en partie à ton analyse, Jacques, d’autant qu’elle correspond à certaines remarques que j’ai faites dans mon texte sur la situation aux États-Unis. Il n’empêche que, par-delà la pratique rituelle des commémorations, on note un certain regain d’intérêt pour la tradition de soulèvement contre le pouvoir anglais et, plus intéressant encore de mon point de vue, pour la résistance à l’esclavage qui a conduit à la guerre de Sécession. En effet, les États esclavagistes, longtemps dominants au Congrès, ont pu faire voter en 1850 une loi faisant obligation aux États du Nord de concourir à la capture des esclaves fugitifs. Cette loi et la chasse aux fugitifs ont poussé un État du Nord après l’autre à adopter des lois contraires à cette loi fédérale et ont déclenché des affrontements violents. En Pennsylvanie, un esclavagiste venu reprendre ses esclaves a été tué sur place et les 41 inculpés ont été rapidement prononcés non coupables par un jury populaire.
Surtout dans le Massachusetts, cœur du mouvement abolitionniste, il a fallu envoyer la troupe fédérale en 1854 pour récupérer un seul esclave à Boston. Puis, à Worcester, grand centre industriel, un chasseur d’esclaves a échappé de peu au lynchage par la foule. Or dans cette même ville, l’inspectrice des écoles publiques a envoyé cette année une circulaire rappelant que les écoles ne demandent pas le statut légal des immigrés et qu’elles ne comptent pas se concerter avec l’ICE (police de l’immigration et des douanes).
Pourquoi citer cet exemple ? Parce qu’une certaine conscience du passé semble se raviver et qu’un aspect essentiel du militantisme au quotidien tourne en ce moment autour de la protection des étrangers, et pas seulement à Los Angeles, ville sur laquelle tous les projecteurs étaient braqués en juin. Cette question a été largement présente dans les rassemblements du 14 juin dans le reste du pays. Certes, nous en sommes encore loin de l’idée du renversement d’un régime, mais si je souligne cet aspect-là, c’est parce que le précédent historique — mouvement abolitionniste-guerre de Sécession-émancipation-Reconstruction — était en fait le temps fort de la révolution bourgeoise aux États-Unis : la guerre d’Indépendance a représenté une rupture importante du point de vue des représentations mentales, mais a laissé intacts les rapports de propriété, alors que la séquence des années 1860 a entraîné une vaste expropriation et la brève constitution de régimes où d’anciens esclaves devenus des citoyens ont pu se faire élire et défendre leurs intérêts en tant que petits agriculteurs, métayers ou ouvriers agricoles. Quant aux grands noms des familles de planteurs, une quarantaine d’années plus tard, plus un seul ne faisait partie du gotha américain. Une classe sociale entière avait disparu…
Pour revenir à la réalité actuelle, si on peut constater la tendance à vouloir se compter en vue des prochaines élections et d’un retour à la normale (= pouvoir des Démocrates), les contestataires ne restent pas pour autant passifs. Des collectes ont été faites au cours de manifestations pour les salariés licenciés par le DOGE, des rassemblements se font devant des centres de détention des immigrés, les agents de l’ICE ont du mal à trouver un hôtel où ils peuvent dormir tranquilles (comme dans la ville de Pasadena, où la direction de l’hôtel a fini par les engager à repartir face aux manifestants dehors). Bref, le refus d’un pouvoir arbitraire prend en tout cas une forme active, même s’il semble pour le moment rester dans le carcan de l’alternance électorale à l’américaine. À suivre donc.
Larry
Notre bref article envisage une réponse à la question suivante d’une de nos correspondantes : « Encore un texte sur les dépenses militaires US (https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/07/03/nourrir-letat-guerrier-nous-perdons-les-fabricants-darmes-gagnent/). J’aimerais bien comprendre dans quelle mesure elles participent (ou pas) de la « bonne santé » de l’économie américaine, de vos points de vue respectifs ».
Nicole,
Le but de cet article n’est pas tant de montrer un niveau de dépense militaire américain sur lequel d’ailleurs l’auteur ne s’attarde pas, que ce soit du point de vue statistique ou de celui de l’argumentation, mais d’opposer l’État guerrier américain d’aujourd’hui (l’État trumpiste) à l’État-providence vertueux (de Biden ?). C’est une affirmation bien aventureuse puisque l’exemple historique de Roosevelt montre qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre les deux ou plutôt que l’opposition n’est pas probante. Comme souvent sur ce type de site ou dans le Monde diplomatique, il ne s’agit que de critiquer le néolibéralisme, c’est-à-dire le mauvais capitalisme. On ne s’attardera donc pas sur le texte, mais essayons rapidement de te répondre.
Si on regarde les statistiques mondiales vite fait, les dépenses américaines sont énormes en valeur absolue, ce qui est logique vu la taille du PIB américain, mais pas si élevées que cela en valeur relative, par exemple par rapport à la Russie ; et de plus, ces dernières années, elles augmentent bien plus, toujours en valeur relative, dans des pays de l’OTAN proches de la frontière russe (un grand bond polonais) et au Mexique, en Arabie saoudite, Israël et bien sûr en Ukraine1. Par ailleurs, on peut estimer que Trump procède à un rattrapage des années antérieures où l’étiage2 était tombé assez bas.
Peut-être faut-il distinguer les dépenses de sécurité immédiate et le complexe militaro-industriel, avec aux EU un lien très étroit entre recherche militaire et civile et recyclage des moyens (cf. l’ordinateur). Autre point : pour ce qui est de la « bonne santé », tant que les investissements et la R&D dans le domaine militaire rapportent à moyen terme ou long terme plus que ce qu’ils coutent à court terme (les dépenses militaires), c’est bon pour l’« économie » et, d’une manière plus globale, la Seconde Guerre mondiale a été très profitable aux EU aussi bien du point de vue de la puissance du capital américain que de la hausse du niveau de vie. Il n’en est évidemment pas de même pour l’Allemagne, le Japon et l’Italie, qui vont désormais tirer leur puissance économique du désarmement forcé qui leur est imposé, sous parapluie américain, ce que Trump veut maintenant leur faire payer ou rembourser en les forçant à augmenter leurs dépenses de défense en proportion de leur PIB, comme d’autres présidents américains avaient essayé de le faire dès la fin des années 1970, en faisant pression sur le DM et le Yen. De cela il ressort qu’il n’y a plus de lien mécanique et unilatéral entre dépenses militaires et puissance globale d’un État. Non sans raison, mais avec beaucoup de mauvaise foi (Obama le disait de façon plus hypocrite), ce que dit Trump, c’est que la stabilité mondiale de l’ordre capital (le niveau I de l’hyper-capitalisme, disons-nous) coûte cher et que chacun doit y contribuer. Depuis la fin de l’URSS et jusqu’aux présidences Bush, les EU assuraient encore les opérations de police internationale pour maintenir la fluidité des robinets de pétrole et marchandises ; mais pour Trump, ce temps est fini et désormais chaque puissance doit le montrer dans la prise en charge de sa zone d’influence ; une version plus multipolaire et moins stratégique de l’ancienne politique des blocs de la guerre froide, en théorie plus souple et complémentaire avec la globalisation, mais non sans tension (EU-Chine3).
Contrairement à ce que pensaient les marxistes pur jus, le capitalisme n’a plus absolument besoin de la guerre pour sortir de la contradiction valorisation/dévalorisation, la seconde par la guerre relançant la première, parce qu’il a englobé cette contradiction à travers une tout autre dynamique. Dit trivialement, l’information domine la sidérurgie du point de vue économique comme stratégique. Le Japon a battu les EU par l’électronique et non par l’armée de l’empereur ; l’Allemagne a battu les EU par la Volkswagen et non par Thyssen-Krupp.
Par ailleurs, pourquoi s’étonner ? On comprend une certaine préférence pour les dépenses militaires comme moyen de maintenir ou de renforcer la puissance industrielle et l’avance technologique du pays (le point de vue de Stephen Miran), d’autant qu’elle a largement fait ses preuves par le passé. Et comme en outre les entreprises et les circuits existent déjà, c’est moins compliqué de procéder ainsi que de créer ou de recréer des secteurs négligés depuis longtemps en vue de restaurer la grandeur industrielle de l’Amérique, comme dit l’autre, sans compter que cela présente l’avantage de pouvoir être piloter par l’État. Pour finir, on se doutait bien que Trump n’allait pas privilégier l’écologie, les services sociaux ou les festivals culturels.
Jacques W. et Larry C., le 6 juillet 2025.
Russie : 4,7, mais doublement du budget entre 2007 et 2023 et + 41 % entre 2023 et 2024. [↩]
Les deux textes « États-Unis : Réorganisation chaotique au sommet du capitalisme » et « Puissance et déclin. La fragile synthèse trumpienne » présents dans le numéro 23 de la revue Temps critiques autour des Etats-Unis tiennent évidemment compte du phénomène Trump, mais ils essaient de ne pas céder à l’actualisme en abordant un contexte plus large. Ils ont tous deux fait l’objet d’une discussion à Paris avec le groupe « soubis » et ont fait l’objet de comptes-rendus collectifs de la part de ce même groupe que nous publions.
Dans « Puissance et déclin. La fragile synthèse trumpienne » il s’agissait de sortir de cette mode post-moderne qui réintroduit du binaire pourtant dénoncée par ailleurs. Rapporté aux E-U il s’agissait de tenir les 2 bouts en réaffirmant le maintien de leur statut de puissance au sein d’un monde occidental globalement en déclin parce que son progressisme originel s’est épuisé. Dans cette mesure le trumpisme n’est pas un nouvel extrémisme mais une tentative d’improbable synthèse entre accélération capitaliste et conservatisme.
JW : Larry et moi avons travaillé de façon indépendante, donc nos articles ne se chevauchent pas. Je traite du contexte plus global, Larry de la situation plus particulière aux USA.
J’ai en effet voulu remettre en perspective théorique et historique la question du déclin ou celle de décadence puisqu’elles réapparaissaient aujourd’hui en filigrane autour de la politique de Trump et de son équipe. C’est pourquoi, sans cuistrerie aucune, j’ai cité Derrida et Lyotard, qui sont des auteurs assumés de la décadence.
A propos des USA, on parle de déclin de puissance par rapport à la Chine et de déclin de la démocratie. Or une puissance peut être hégémonique et en déclin du fait de contre-tendances fortes à sa domination. Trump a bien conscience du déclin : les mesures protectionnistes sont toujours une forme de défense des puissances dominantes par rapport au dynamisme produit par le libre-échange. Aspect malthusien de sa politique économique : le pays participait largement à la « globalisation heureuse » et au donnant-donnant que présupposait le développement de l’OMC ; or la crise sanitaire a montré que la division internationale du travail ainsi créée avait amené les pays à trop se spécialiser : une harmonie illusoire donc, qui indique que la complémentarité économique peut se transformer en concurrence en période de crise. La question nationale et politique n’est donc pas réglée, car les accords entre les puissances au sommet n’empêchent pas les conflits. Cette division internationale du travail fonctionne encore, mais une vision critique souverainiste déjà repérable avec le Brexit s’est développée. Et par exemple, dans la vision trumpienne, il n’y a pas que des gagnants si le « gâteau » n’augmente plus de taille.
La question de l’Ukraine a aussi montré que les questions géopolitiques pouvaient intervenir dans le cadre de cette nouvelle tendance souverainiste à l’oeuvre.
A : Je pense qu’il y a un déclin économique. Reste à voir si c’est inéluctable ou non. Ce sont les ruptures qui se créent dans le monde qui sont intéressantes. Dans certains textes, on veut voir une continuité entre Démocrates et Républicains sans voir les ruptures en cours.
JW : Larry voit beaucoup plus la continuité, je vois un peu plus de discontinuité, mais on est d’accord tous les deux pour dire que la puissance économique des USA demeure : voir les chiffres avancés dans ma brochure sur les investissements directs à l’étranger (IDE), la puissance des firmes multinationales (FMN) américaines et leur énorme pouvoir de capitalisation qui mesure bien plus la puissance qu’un niveau de PIB.
G : Je suis impressionné par la quantité des éléments que tu fournis, mais ne comprends pas où tu veux en venir. Dans ta conclusion tu parles des « lumières noires » qui nous ramèneraient à une spécificité occidentale mais non universaliste, comme avant la Première Guerre mondiale. Que vois-tu comme perspective à partir de là ?
JW : On a dû boucler les textes très vite pour garantir la sortie de la revue d’où le fait que certains points sont posés plus qu’explicités. Les attaques contre les Lumières traditionnelles et l’universalisme qui sont portées aux Etats-unis proviennent aussi bien des tendances de la nouvelle droite américaine que de la gauche démocrate, et de fait elles se rejoignent, fragilisant un possible retour à la question sociale par la polarisation sur le débat woke/antiwoke. De ce point de vue il n’y a guère de perspective pour nous, puisque le combat pour l’hégémonie culturelle se joue en fait dans la perspective américaine, d’où par exemple l’extension des courants racialistes dans le monde, alors que jusque-là la question de la race était considérée comme une spécificité américaine et le concept négligé ailleurs. Donc, si perspective il y a, c’est en dehors ou au-delà de cette polémique idéologique. Sur le terrain comme l’ont fait les GJ. Mais pour le moment on ne voit rien venir comme pôle significatif de résistance, malgré le côté inquiétant de ce qui se passe aux Etats-Unis comme en Allemagne.
G : La Californie, c’est l’extrême Occident.
A : C’est un camp à l’intérieur de ces pays qui remet en question les valeurs des Lumières.
JW : Cela rentre dans le cadre de la bataille pour l’hégémonie culturelle. Mais celle-ci est aussi définie par l’évolution des rapports de classe. Ca n’entre pas dans la tradition du mouvement révolutionnaire ni ouvrier : c’est pour cela que ça nous secoue. On observe un retour en grâce de l’idéalisme – voir l’usage de Gramsci par des gens de tout bord. L’insistance sur l’aspect performatif (imposer la révolution par le langage) se retrouve dans tous les termes employés par les essayistes, qui cherchent à nommer les choses pour les faire exister.
G : Allusion finale du texte. Allusif aussi dans « le premier des déclins est celui de la gauche qui n’a plus rien à dire que la défense de l’Etat de droit protecteur ».
JW : C’était exceptionnel de voir la presse quotidienne défendre l’existence d’institutions américaines vilipendées encore hier, mais qui trouvent un retour en grâce (de l’OMC jusqu’à l’OTAN, en passant par CNN et les grandes universités de classe) du simple fait qu’elles sont attaquées aujourd’hui par Musk, et aussi la prolifération d’articles sur l’Etat de droit et sa pure défense du pouvoir judiciaire sans analyse théorique de l’Etat. Simple désir de retour à une légalité de société capitalisée enserrée dans des règles normatives acceptables. Le trumpisme serait illégal. Il s’agissait alors, pour la bonne gauche démocrate d’essayer de faire la différence entre un Etat de droit et un état d’exception. Tous les états d’exception ont fait attention à la dimension de l’Etat de droit. C’est ce qui les différencie des Etats issus de pronunciamentos (ex. Argentine ou Afrique), où il n’y a pas de Constitution ni d’élections, où l’armée intervient en tant que corps de la nation. La défense de l’Etat de droit par la gauche se fait maintenant au nom de la défense des acquis. Le risque est qu’aux échappements des démocraties dites illibérales et à leur durcissement répressif ne soit opposé qu’un retour à la démocratie libérale. Une exigence de légalité bien plus que de légitimité, qui ne peut guère être mobilisatrice.
G : Dans un passage tu montres une fracture au sein du capital. Paradoxalement ces gens dénoncés autrefois par la gauche sont perçus comme un rempart face au trumpisme. Ce que cela montre, c’est l’effondrement de la capacité de la gauche à penser autre chose. Ce que le trumpisme vient mettre en lumière.
JW : Il passe tout au révélateur parce qu’il contredit l’idée qu’il s’agit d’un système où rien ne serait repérable et où tout irait dans le même sens parce que suivant un « plan du capital ». Rien de plus faux pour nous. La victoire de Trump et la recomposition du pouvoir qui s’effectue autour de lui sont plutôt le signe de la dureté des luttes entre fractions du capital, comme je le développais dans un précédent numéro. J’y attirais aussi l’attention sur « la démocratisation du capital » (fonds de pension et capital fictif) et ma critique de toute théorie en termes de pouvoir oligarchique. En effet, l’apparition et le développement des plateformes a été favorisé par la financiarisation du capital, et cette même « démocratisation » a aussi affaibli les positions hiérarchiques héritées. Je parlais alors, dans ce numéro 21 de la revue, des fractions financières ; cette fois, autour de Trump, il s’agit des fractions technologiques. Il y a un renouvellement des élites. Il ne faut pas oublier que dans la modernité le brassage s’est toujours fait par le biais des classes moyennes, et cela dès le développement des villes et de la première bourgeoisie, avant même la Révolution française par exemple, parce que ce sont les lieux de brassage entre nouvelles et anciennes couches (par exemple, plus personne ne parle en termes de petite bourgeoisie parce que cette ancienne fraction propriétaire a été remplacée par les nouvelles couches moyennes salariées). A présent on observe un peu le même phénomène dans les cercles dirigeants : ce sont les marginaux de la classe capitaliste qui ont formé des fractions très dynamiques et les plus innovantes, parce qu’elles n’avaient rien à perdre (elles n’avaient rien accumulé) et tout à gagner, le risque étant pris par d’autres (capital-risque) en échange du contrôle de la capitalisation finale. C’est encore plus net aux USA où la mobilité est bien plus forte, mais en France il y a eu une mise au rancart progressive des capitalistes traditionnels (voir l’évolution du CNPF devenu Medef et maintenant dirigé par les secteurs de pointe et non plus par les mines et la sidérurgie).
A : Les idées nouvelles viennent des classes moyennes ?
JW : Oui, car ce sont les classes du brassage des idées et des pratiques ; elles ne viennent jamais de l’aristocratie ni du prolétariat (l’idée de révolution, contrairement à celle de révolte ou d’émeute, est bourgeoise et sera seulement reprise plus tard par le prolétariat). Mais il faut qu’il y ait des possibilités. La « révolution du capital » l’a permis.
A : La grande rupture d’aujourd’hui est portée par des puissants.
JW : Ce gens-là ont remplacé les dynasties. Il faut voir aussi combien de gens de la finance ont chuté. Ce sont des fractions du capital sans assise stable, ni héréditaire, ni fonctionnelle, ni juridique. La source de leur puissance, c’est la prise de risque, l’innovation, la circulation, pas l’accumulation.
A : Ceux qui financent sont souvent des héritiers. Les ruptures actuelles ne sont pas seulement sociétales. La gauche a des raisons d’être inquiète de l’illibéralisme montant. L’Etat de droit, c’est un rempart par rapport à cette autre chose qu’est le trumpisme. Bernard Aspe dans Lundi matin (https://lundi.am/La-division-du-politique) dit vouloir reconstituer un mouvement révolutionnaire, il reprend des concepts comme « matérialisme historique », ramène la question du travail.
JW : Je n’ai jamais attaqué le libéralisme. Ceux qui l’ont fait ne s’attaquaient pas au capitalisme, ils voulaient réinstaurer le programme du Centre national de la Résistance. Le libéralisme est une des formes du capitalisme. Démission théorique de la gauche avec rattachement à l’Etat. Dans les luttes c’est souvent l’Etat qu’on a en face de nous et non pas le « patronat », car le capital est plus que jamais puissance et pouvoir (et non pas taux de profit, ce que ne peuvent comprendre les tenants du décrochage entre « économie réelle » et finance – économie irréelle !).
N : On se trompe en parlant de crise du capitalisme ?
JW : Il n’y a pas de crise finale, pas de parachèvement, le capitalisme a gagné (au moins pour l’instant) par sa dynamique de fuite en avant autant que par la résolution qu’il apporte à ses contradictions ; il essaie de les englober. Dans sa dynamique, le capitalisme se nourrit des luttes (de classe), comme on a pu le voir après les mouvements d’insubordination des années 1960-1970, mais, même en leur absence significative, il ne supprime pas tous les conflits. Il n’a ainsi résolu ni la question de la religion ni la question de la nation. Le dépassement de la nation s’est avéré en partie illusoire. Elle revient sous la forme des souverainismes et de l’isolationnisme, ou à l’inverse par le retour de certaines tendances impériales comme en Russie.
Avec Trump le souverainisme n’est pas équivalent à la forme Brexit : il n’est pas pur isolationnisme, mais coexiste avec une théorie des zones d’influence (Amérique centrale et du Sud pour lui, éventuellement Canada ; Europe de l’Est pour la Russie, Taiwan pour la Chine, etc. Ce retour à l’expression d’une puissance nationale vient bloquer le fonctionnement du capitalisme du sommet tel qu’il s’était organisé à partir de l’OMC au niveau de la division internationale du travail et des G7 à G+++ qui lui ont succédé.
N : Pourtant, Internet et le rôle des plateformes, ça tend plutôt à effacer les frontières nationales.
JW : Toutes les mesures de Trump sont anti-plateformes. C’est aussi instable que le sont les différentes luttes de fraction pour le partage ou la prédominance du pouvoir…
G : Ce n’est pas un retour du nationalisme, c’est autre chose. Autrefois, le nationalisme correspondait à l’émergence de nouveaux Etats cassant les empires (Autriche-Hongrie et Russie) et ensuite à l’affrontement entre Etats repus (Grande-Bretagne et France) et Etats faméliques (Allemagne, Italie, Japon). C’étaient des sociétés jeunes, en recherche d’expansion. Les Etats-Unis ont profité de ces affrontements pour affirmer et consolider leur suprématie. Les souverainismes d’aujourd’hui sont des formes de repli sur soi : des sociétés vieillissantes qui ont peur des nouveaux arrivants, qui fuient les guerres qu’elles ont elles-mêmes alimentées. Exemple du Brexit. Pour ce qui est du retour des zones d’influence, il faut se rappeler qu’on les a connues à l’époque de la guerre froide.
JW : Fluidité et non pas fixité de l’époque de la guerre froide.
La Chine est la grande gagnante de la période OMC.
N: Tout ça donne l’impression que la classe dirigeante ne sait pas où elle va.
JW : Parce qu’il n’y a plus de classe dirigeante au sens de l’ancienne bourgeoisie et cela au moins depuis les années 1930 et 1940. D’où le fait qu’ait fleuri, à l’ultragauche, la théorie d’un « capital automate » déjà quelque peu esquissée par Marx dans les Grundrisse. D’où aussi, mais en contrepoint, mes notes sur les fractions du capital.
On vit une accélération qui se met hors du temps historique. Fuite en avant. Cela correspond aussi à la transformation des éléments de base du capitalisme. Dans un système fondé sur la circulation de l’information, il n’y a plus de processus de longue durée comme celui qui a permis la formation de la classe bourgeoise. Le temps de l’accumulation est très lent. Même la révolution industrielle s’est faite lentement. Aujourd’hui le rythme est plus rapide pour tout le monde, la diffusion des innovations, la circulation des marchandises se sont accélérées. Les théories classiques de l’échange étaient fondées sur l’idée que le capital fixe (les immobilisations patrimoniales) ne circulait pas, seules le faisaient les matières premières (rapports coloniaux) et la force de travail (immigration), c’est-à-dire ce qu’on appelle techniquement le « capital circulant ». Par exemple, Staline et Mao, mais aussi l’Inde, pour d’autres raisons, avaient décidé de faire avec leurs propres forces. Mais aujourd’hui il est impossible d’empêcher la circulation du capital non seulement à travers la puissance loin d’être nouvelle des FMN, qui se rattachait plus à l’ancienne forme de domination impérialiste, que par le poids des investissements directs à l’étranger. Le développement du capitalisme n’est plus essentiellement par enclaves, comme avant la révolution du capital, car, avec la globalisation, la diffusion des innovations est formidable et bouleverse l’ensemble des conditions de vie — avec, par exemple, l’urbanisation sauvage, la production agricole intensive sous OGM, les élevages en batterie.
A : Autrefois les productions étaient proches de leurs marchés. L’énorme concentration du capital conjuguée à plusieurs révolutions techniques (porte-conteneurs, télécoms…) ont permis la mondialisation.
JW : On a connu les start-up sous d’autres formes (cf. les majors, qui faisaient travailler des « indépendants » dans le secteur artistique). Aujourd’hui c’est caricatural car tu fructifies à partir de rien.
N : Une démondialisation est-elle concevable, à ton avis ?
JW : Relocaliser artificiellement est impossible. Tout le monde est pris. C’était possible quand les Etats avaient une autonomie (une production et un marché national et colonial autosuffisant permettant la fermeture des frontières), autonomie qui a mené à la guerre comme dans les années 1930. Or, quelque chose qui pousse en avant empêche de revenir en arrière. Revenir à un temps historique ne peut venir que de luttes qui perturberaient la « fuite effrénée du monde », comme nous le disons en sous-titre de couverture de notre dernier numéro de la revue. La relocalisation ne pourrait se faire que sous une forme nouvelle d’artisanat, et encore, car l’exemple allemand de la petite et moyenne entreprise et de l’apprentissage bat de l’aile.
La fraction technologique du capital, au-delà de la dimension géopolitique de la lutte entre grandes puissances, vise à imposer une nouvelle vision du monde qui remplace l’ancienne Weltanschauung bourgeoise (d’où à nouveau l’idée de conquête de l’espace, le développement de l’IA, le transhumanisme). Encore plus que l’adhésion à la notion de progrès, il s’agit, pour les décideurs ou autres influenceurs, d’obtenir une adhésion immédiate de la population au « tout est possible ». Ce qui est grosso modo le cas et renvoie, pour le moment du moins, les actions de résistance à l’éclatement ou/et à l’infinitésimal.
Pour faire face, peu d’alternative et de marge de manoeuvre et au niveau théorique, cf. La synthèse de R. Garcia dans Le Désert de la critique. Avant, deux visions du monde s’opposaient et surtout une perspective (ex : « socialisme ou barbarie »). Puis période sans visions autre que le vague des « alternatives ». Aujourd’hui, une vision qui pousse à l’accélération, très en prise avec le quotidien, avec adhésion objective et subjective parce que, sensiblement et aussi insensiblement, il y a une transformation des rapports sociaux. La dépendance réciproque capital/travail, sans cesser d’exister, est aujourd’hui incluse dans une dépendance réciproque qui dépasse la seule exploitation pour toucher à une aliénation plus générale, mais contradictoire : dit autrement, à une coexistence entre aliénation et libération/émancipation. Exemple : avant, si j’étais obligé d’aller travailler, je n’étais pas obligé d’avoir une voiture, un téléphone ; aujourd’hui, je suis bien plus contraint. Les robots accèlèrent les choses. On est contraint et pris dans cette vision du monde. En vingt ans il s’est dégagé une vision, on n’est plus dans une simple nouveauté techno avec laquelle on peut jouer.
Mais dans ce processus, tout ne se joue pas à la même vitesse. Le marasme de l’industrie automobile européenne et particulièrement allemande est lié à son impossibilité à accélérer à la même vitesse que les entreprises plus jeunes du même secteur, mais agissant à l’autre bout du monde et dans un pays qui n’est pas limité par les mêmes barrières capitalistes. Ce qui faisait sa force était son avancée à un rythme maîtrisé basé sur des savoir-faire, les avantages sociaux de la classe ouvrière allemande en tant que catégorie sociale et non pas en tant que classe antagonique (cogestion, 32 à 35 heures dans la grande industrie, etc.) et des innovations de confort. La seule défense qu’elle peut avoir, c’est de retarder le moment de l’application des mesures et préparer des plans sociaux.
Le poids des entreprises dans les décisions est aujourd’hui fonction d’une structuration plus globale (au niveau de l’hypercapitalisme, comme on le voit par rapport aux questions de climat). Les lieux de décision ont changé : ils sont non seulement encore répartis et hiérarchisés verticalement, mais aussi organisés horizontalement en réseaux.
A : Zuckerberg est le seul à prendre des décisions dans sa boîte. Les entrepreneurs font tout pour s’émanciper des mesures gouvernementales.
JW : Ce sont les libertariens. Mais il y a aussi des entrepreneurs en marge qui ne sont pas dans l’establishment ou la politique.
On est dans un temps du capital qui n’est plus celui de la bourgeoisie qui intégrait le temps historique dans la mesure où il intégrait aussi les luttes de classe et la notion de conflit — la « grande politique », comme disait Mario Tronti. Mais là j’anticipe sur mon livre à venir…
Les deux textes présents dans le numéro 23 de la revue autour des Etats-Unis tiennent évidemment compte du phénomène Trump, mais ils essaient de ne pas céder à l’actualisme en abordant un contexte plus large. Ils ont tous deux fait l’objet d’une discussion à Paris avec le groupe « soubis ».
Ils ont fait l’objet de comptes-rendus collectifs de la part de ce même groupe.
Voici le premier autour du texte de Larry « États-Unis : révolution politique et réorganisation chaotique » au sommet du capitalisme, dans lequel Larry maintient l’hypothèse d’une puissance américaine qui perdure, malgré tout.
Durant la présentation, Larry compte mettre en évidence les questions les plus importantes.
On assiste à des bouleversements importants. Le deuxième mandat de Trump est un vrai événement. Son refus de reconnaître sa défaite face à Biden en 2020 et l’amnistie des meneurs de l’assaut contre le Capitole en janvier 2021 étaient sans précédent. Qu’une partie de la droite US trouve cela acceptable en dit long par ailleurs sur le climat politique. En outre, Trump procède systématiquement par décrets (executive orders) plutôt qu’en s’en remettant au vote de lois par le Congrès. Cela témoigne de la volonté de concentrer le pouvoir, Trump faisant comme si la légitimité politique émanait de lui seul. Ne pas oublier que Trump est avant tout un homme d’affaires : il gouverne comme on dirige une entreprise. Or, une partie de la population adhère à cette politique spectaculaire en y voyant de l’efficacité.
Le fonctionnement habituel de la politique, la séparation des pouvoirs notamment, est vu comme laborieux et inefficace. Trump dit : « Je ne m’embarrasse pas de tout ça, je gouverne par des décrets ».
Par rapport à son premier mandat quand il paraissait peu expérimenté et donc obligé de s’appuyer sur des professionnels de la fonction publique, il s’est entouré de gens montrant une fidélité sans faille, y compris de conseillers incompétents. Le nombre de collaborateurs issus de la chaîne Fox News est un exemple qui illustre bien cette situation. A ce propos, on a en mémoire l’affaire du « Signalgate ». Mike Waltz, le conseiller national à la sécurité de l’administration Trump, a invité par mégarde dans une conversation concernant le bombardement de positions houthis une personne non autorisée (un journaliste).
Pour la gauche, c’est la crise du capitalisme US face à la Chine qui permet d’expliquer la politique de rupture et l’autoritarisme ouvert de Trump. Il y a du vrai et cela explique le choix d’un entourage de gens fidèles.
Parmi les inspirateurs de Trump, il y a Roy Cohn. C’est un juriste qui a condamné les époux Rosenberg. Il doit sa notoriété aux enquêtes lancées par le sénateur Joseph McCarthy à l’époque des campagnes anticommunistes. Il a en son temps (il est mort en 1986) défendu des mafieux, avant de devenir le mentor du jeune Trump. Son mot d’ordre « Attaquer, contre-attaquer et ne jamais s’excuser » semble être la devise de l’administration actuelle du reste.
Les droits de douane sont une obsession de Trump depuis les années 1980, et il n’est pas sorti de cette mentalité : nous nous sommes fait avoir hier par les Japonais et aujourd’hui par les Chinois. Pourtant, les flux financiers sont largement au profit des USA, même si la balance commerciale des USA est déficitaire. Même s’il rencontre des échecs, il ne démord pas des droits de douane.
S’il doit négocier à la baisse par rapport à ses premières exigences, il y a pourtant bien un accord, avec la Grande-Bretagne (pratiquement le seul pays important avec lequel les USA ont un excédent commercial). Avec la Chine, les USA ont dû céder car elle a refusé de jouer le jeu. Mais Trump essaie de maintenir ses partenaires dans l’insécurité, cela fait partie de sa politique.
Autre élément : Trump essaie de remettre la politique au centre. Il croit en effet au populisme, même si l’idée que le peuple américain se fait avoir est une vision simpliste. Cela plaît à son électorat de base en tout cas.
La plupart des milliardaires se sont ralliés sur le tard à Trump. Steve Bannon ne s’est d’ailleurs pas gêné pour le dire. Trump a pourtant fait du tort aux multinationales US (la « Tech » notamment). Parler de l’accession des oligarques au pouvoir dans ces conditions n’a pas grand sens. Au mieux, c’est une banalité puisque les capitalistes n’ont jamais cessé d’influencer Washington. Mais ce n’est pas eux qui déterminent la politique de Trump de toute façon.
Pour Larry, Trump a en tête un régime inspiré par les militaires au pouvoir en Amérique latine (ou ailleurs dans le tiers monde) dans les années 1960-1970 : des régimes autoritaires sur fond de capitalisme mafieux. Un exemple : le cadeau offert dernièrement à Trump par le Qatar. La ministre de la Justice est une ancienne lobbyiste du Qatar…
Dans ces conditions, on peut parler de politisation à outrance du gouvernement…
Pourtant, il n’y a pas que de l’incompétence. Les liens avec les nouvelles technologies sont en effet forts : au centre se trouve le patron de Paypal (Peter Thiel). Ces chefs d’entreprise s’allient avec Trump parce qu’ils veulent maintenir l’hégémonie des Américains. Parmi les rallié-es à Trump, il y a des gens qui ont une vision pour l’Amérique. Ce serait par conséquent une erreur de ne voir dans la situation actuelle que de l’irrationalité.
On ne peut donc pas parler d’un pays qui sombre. Il y a des investisseurs et des ingénieurs, souvent d’origine étrangère, attachés au pays, qui entendent maintenir le rang des USA. Or, ils ont des compétences techniques non négligeables. Ils se sont mis au service de Trump (et des USA). Il y a aussi la volonté de renouer avec la politique des grands projets. L’exemple le plus évident est le « Dôme d’or », sans doute le projet d’investissement militaire le plus ambitieux depuis la « Guerre des étoiles » du début des années 1980. Il s’agit d’une protection des USA à base de satellites sur le modèle du « Dôme de fer » d’Israël. Tesla et Palantir Technologies pourraient décrocher le marché.
Les « trumpistes » ont surfé sur la vague anti-wokes largement partagée au sein des classes populaires. Les Démocrates n’ont pas du tout compris cela.
La gauche démocrate présente les « trumpistes » comme racistes, réactionnaires, homophobes… Or, il y a des homosexuels y compris chez les « trumpistes » (dont Scott Bessent, secrétaire au Trésor, marié à un homme avec qui il élève deux enfants), sans que l’on entende les conservateurs chrétiens s’en plaindre. Les électeurs de Trump non plus d’ailleurs. Le vice-président est marié par ailleurs avec une Indienne. Les Démocrates n’ont donc plus le monopole de la diversité. A l’heure actuelle, la seule minorité qui semble faire figure de paria chez les « trumpistes », ce sont les Noirs. La gauche n’a pas vu que les conservateurs ont réussi à s’approprier d’une certaine manière la diversité pour la retourner contre leurs adversaires.
Sur la réforme de l’État fédéral et la commission pour « l’efficacité gouvernementale » (DOGE), certain-es ont dénoncé des opérations de corruption mais elles et ils ont échoué à le prouver. Reste que la réforme risque de coûter plus cher que de tout laisser en l’état…
Quant à la fin de l’aide au développement US : ce serait 20 000 morts à court terme.
Lutte contre l’immigration : le gouvernement Trump a tenté de faire de véritables razzias dès les premiers jours de l’investiture. Mais les autorités ont rencontré des problèmes logistiques : places dans les prisons et les centres de rétention insuffisantes, et tarissement du flux des arrivées à la frontière. C’est la raison pour laquelle les expulsions ont été très faibles. La Cour suprême s’est en outre opposée à cette politique d’expulsions sans procédures justes. Comme Trump refuse les verdicts de la Cour suprême dans certains cas, on peut parler de véritable crise constitutionnelle.
L’opinion publique est pourtant du côté de Trump et soutient sa politique anti-immigrés. Certains électeurs républicains, respectueux de la Constitution, ont d’ailleurs interpellé les élus à ce sujet.
Cette résistance est faible. Il y a les tribunaux qui réagissent de plus en plus. Il en va de la raison d’être des juges : que deviennent-ils si le droit n’est plus respecté ? Or la Cour suprême ne peut pas les désavouer. La population fait confiance aux juges. Mais une juge a été arrêtée par le FBI car elle refusait l’intervention de la police des frontières sur une affaire concernant un étranger et doit passer en procès. Elle a déclaré qu’elle devait assurer la sécurité des justiciables dans l’enceinte de son tribunal.
Il y a eu des petits rassemblements contre Trump et sa politique, mais la majorité des contestataires fait confiance aux Démocrates.
Les Démocrates vont sûrement gagner les prochaines élections. Une partie du capitalisme US — la grande distribution par exemple — ne peut pas supporter des droits de douane élevés. Par ailleurs, les Républicains sont divisés sur la politique à mener. Les MAGA veulent maintenir une protection sociale, les autres Républicains non.
Nous avons le plaisir de vous informer de la parution du numéro 23 de la revue Temps critiques
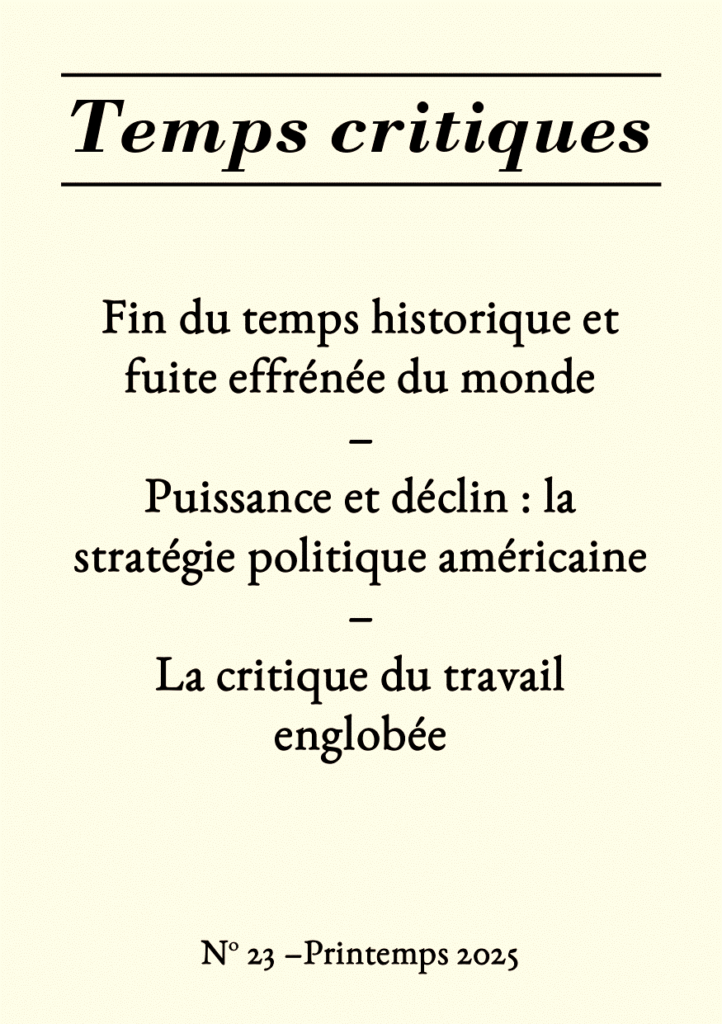
Sommaire :
Le capital : une brève mise à jour
Temps critiques
Des immigrés aux migrants
Temps critiques
Etats-Unis : révolution politique et réorganisation chaotique au sommet du capitalisme
Larry Cohen
Puissance et déclin : la fragile synthèse trumpienne
Jacques Wajnsztejn
Introuvable kathêkon, réflexion à partir du dernier Tronti
Jacques Guigou
L’achèvement du temps historique
Jacques Wajnsztejn
Approche provisoire d’un dualisme problématique
Venant
Le chemin étroit de la critique du travail
Gzavier et Julien
La critique du travail englobée
Gzavier et Julien
La tendance du capital à privilégier la capitalisation (ses formes liquides et financières) plutôt que l’accumulation (de nouvelles forces productives et immobilisations), s’appuie sur une organisation dans laquelle les flux de production et d’information, de finance et de personnes, dépendent des jeux de puissance au sein de réseaux interconnectés, mais malgré tout hiérarchisés. L’État a perdu l’autonomie relative qui était la sienne dans la société de classes à l’époque des États-nations. Il ne peut plus être perçu comme la superstructure politique d’une infrastructure capitaliste comme le concevait le marxisme. Son passage progressif à une forme réseau à travers laquelle il est présent, actif et englobant, tend à agréger État et capital. L’État n’est plus en surplomb de la société, puisqu’il a recours à différentes formes d’intermédiation qui tendent à transformer ses propres institutions en de multiples dispositifs spécifiques de remédiation. La forme de domination qu’il exerce est basée sur l’internisation/subjectivisation des normes et des modèles dominants. Parmi ces modèles, celui de la technique joue un rôle central dans la transformation des forces productives et des rapports sociaux. Ce modèle technique, induit par le développement capitaliste, s’impose aujourd’hui comme une nécessité absolue et non pas comme un progrès, alors pourtant qu’il est indissociable de choix politiques. Il finit par s’imposer comme une seconde nature. Nous critiquons toutefois l’hypothèse d’un « système » technique autonome ou « macro- système ».
Il en est de même de la notion de « système » capitaliste : le capital ne tend vers l’unité qu’à travers des processus de division et de fragmentation qui restent porteurs de contradictions et réservent des possibilités de crises et de luttes futures. C’est bien pour cela qu’il y a encore « société » mais il s’agit en l’occurrence, d’une « société capitalisée».
L’hypothèse d’une « crise finale » du capitalisme qui possèderait une forte dynamique le poussant à « creuser sa propre tombe » a été démentie par les faits, même si sa dynamique actuelle repose sur le risque et donc suppose la possibilité et l’existence de crises. En effet, le capital n’a pas de forme consacrée, comme le laisseraient supposer ses différentes formes historiques, commerciale et financière d’abord, industrielle ensuite. Cette dernière phase a pu constituer un temps un facteur de stabilisation, remis en cause désormais par la tendance forte à l’unité de ces formes, ce que nous avons nommé la révolution du capital. Aujourd’hui, tout n’est pas que question de profit. Les jeux de puissance des dirigeants, des actionnaires et des créatifs, concourent à une innovation permanente et nécessaire à la dynamique d’ensemble. Mais si ce processus fait encore société c’est parce que le capital n’a pas engendré une domestication totale. Il se fait milieu, valeurs, culture, provoquant une adhésion contradictoire d’individus qui participent ainsi à des modes de vie de la société capitalisée, par exemple à travers une consommation des objets techniques qui tend à virtualiser les rapports sociaux d’où, en retour, l’activation de références à la fois communautaires et particularistes. Nous assistons à ce mouvement au cours duquel la société capitalisée semble s’émanciper de ses contradictions internes parce que nous-mêmes avons pour le moment échoué à révolutionner ce monde.
Prix de l’exemplaire : 10 € port compris
Chèque à l’ordre de : Jacques Wajnsztejn 11, rue Chavanne 69001 Lyon
Abonnement : 15 € port compris pour 2 numéros (dont abonnement à la liste de diffusion du blog)
Soutien : à partir de 35 €
Courriel : tempscritiques@free.fr
Nous vous faisons part de la publication du texte : Puissance et déclin : la fragile synthèse trumpienne. Texte disponible à la lecture sur notre site : https://www.tempscritiques.net/spip.php?article553 et aussi disponible en version A5 livret.
Nous vous proposons ici un compte rendu d’un discussion avec J.Wajnsztejn sur son commentaire critique (ici sur le blog) de l’article de Nancy Fraser « L’impossible démocratie de marché » lors d’une réunion organisée le 27 janvier 2025 par le groupe de discussion « soubis ».
Jacques : L’article m’a été signalé par NT au moment d’un échange avec AD sur Braudel, et de l’envoi sur la liste de citations de Braudel par HD. Il m’apparaissait intéressant sur deux points « théoriques » qui aujourd’hui ne sont pas discutés en milieu militant : le premier sur le lien entre capitalisme et économie de marché, le second entre État, démocratie et capitalisme – la notion de néolibéralisme noie le poisson. Or l’article avait le mérite de poser ces questions. Braudel a regardé comment s’articule développement du capitalisme, du marché, de l’État depuis le XVe siècle. Mais il s’est fait rattraper par ses positions politiques communisantes, ce qui l’a fait adhérer à l’idée de capitalisme monopoliste d’État – qui revient à redorer le blason de l’économie libérale.
La notion de démocratie de marché est liée à des idées de fin XVIIIe. Pour Adam Smith, le marché est une sorte de procédure permettant de développer des valeurs, de calculer le dynamisme sur la base de l’individu rationnel. Il rejoint en cela Hegel. Tocqueville développe l’égalité des conditions, base de la démocratie américaine puis de la révolution française, qui viennent réunir économie et politique (on parle alors « d’économie politique »). Cette réunion va exploser avec le développement de l’économie capitaliste et la tendance à la concentration des capitaux. C’est là que naît la science économique avec les théories « néolibérales » mais aussi la théorie marxiste, qui privilégie de fait l’économie. Polanyi parle de désencastrement de l’économie d’un ensemble qui est fait aussi de morale. Smith juge par exemple anormal que sa fabrique d’épingles produise des ouvriers aliénés incapables d’être des citoyens : la production capitaliste ne fait pas société.
André : Fraser parle aussi la financiarisation de l’économie. Cette idée pèse dans les analyses à gauche. Si c’est inexact, quelles conséquences ? Dans son texte L’âge de la régression, écrit en 2017 juste avant l’élection de Trump, on retrouve ces mêmes analyses. L’élément nouveau dans cet article, c’est l’accent mis sur la démocratie. Son analyse de l’État, qu’elle voit divisé entre économie et politique. Dans cette conception, l’État défend à la fois les intérêts de la société et ceux du capital. Quand le consensus ne fonctionne plus, c’est ça crise, l’interrègne. S’agit-il d’un retour aux idées des années 1970 sur l’autogestion ?
Jérôme : Fraser vient de sortir un livre, Le capitalisme est un cannibalisme. Il s’agit de textes d’intervention. Il faut remettre ça dans les débats politiques qui animent les milieux militants. Elle revient au post-marxisme, en essayant de sortir des débats postmodernistes. Dans Jacobin elle dit qu’elle essaie de sortir du marxisme pour prendre en compte d’autres revendications ; et se demande comment créer une hégémonie culturelle
André : Dans le texte de 2017, elle voit quelque chose de positif à gauche : Syriza et Podemos.
Pierre-Do : En fin d’article, dit que le populisme de droite est gagnant, et que derrière le rideau les gagnants prospèrent. Bien d’accord, mais à la suite elle dit que « ces crises représentent des moments décisifs où la possibilité d’agir est à portée de main ». Et là on ne voit pas…
Jacques : Si j’ai écrit cet article, c’est pour répondre à ce qui est intéressant ou original dedans. Sur l’enjeu question sociale/ questions sociétales, il y a un débat qui se fait et se prolongera, mais ce n’est pas central dans l’article de Fraser et je ne m’y suis donc pas attaché. Le plus important c’est au niveau des notions. « Le capital est hostile à la démocratie », écrit-elle ! Or le développement des échanges se fait par la circulation du capital et avec des États créant des marchés nationaux, à l’intérieur d’un rapport à la démocratie. Quand on fait référence à la démocratie, c’est celle du capital. Pour elle, il existerait une démocratie adossée à l’économie de marché et garantie par l’État.
Mohamed : Ne ferait-elle pas référence à Hayek et l’idée de démocratie limitée ?
Monique : Dans ces textes et dans notre débat, il y a beaucoup de flou sur la notion de démocratie, et plus largement sur le « politique » comme dimension face à l’économique, au capitalismes (et aux diverses formes dans lesquelles il se manifeste).
En effet, parfois il est question du pouvoir politique de façon vague, ou de l’État, ou des institutions juridiques, ou de la démocratie. Or tout cela est différent.
De même, les relations entre le politique et l’économique (entendues souvent comme deux « instances » dans le texte de Fraser) sont formulées dans le débat ici en termes de séparation ou de fusion. Or il est clair que ce qu’il faut réussir à penser, théoriquement et historiquement, c’est l’articulation de ces deux dimensions des sociétés.
Si on prend A. Smith, un des fondateurs du libéralisme économique, il envisage la société civile comme « autonome » par rapport au politique, car elle assure son ordre interne par le marché (il est passé, pour dire très vite, de l’idée de la sympathie à celle de l’intérêt comme base du lien social). Mais pour autant il n’envisage pas la disparition de l’État ; au contraire, l’État doit fournir un cadre juridique qui permette le développement du capitalisme, et même ce que nous pourrions appeler certaines infrastructures.
Les libertariens eux-mêmes conservent les fonctions régaliennes (répressives essentiellement) de l’État.
Bref, pour revenir à la démocratie, on ne peut dire tout simplement que le capitalisme fonctionne de façon évidente avec la démocratie, sauf à réduire considérablement la grande polysémie du terme.
Historiquement, le capitalisme a eu besoin du cadre juridico-politique fourni par le libéralisme politique après le Révolution en France (garantir une société d’individus, le droit de propriété, les théories du contrat et bien d’autres choses encore). Mais pas de la démocratie !! Les libéraux (Siéyès, etc.) étaient antidémocrates, et c’est pour ça qu’ils ont installé un régime (et non une démocratie ) représentatif. Régime qui a été « mal » démocratisé (et partiellement, suffrage masculin uniquement) en 1848, par la révolution.
Tout ça pour préciser que le régime dans lequel nous vivons et qui s’appelle démocratie est une oligarchie représentative, où le vote est biaisé de multiples façons.
Mais la démocratie, au sens authentique, radical du terme, « pouvoir du peuple », participation réelle aux décisions, garde un pouvoir mobilisateur, est un horizon d’attente, contient une dimension utopique, et on ne peut limiter son sens à celui des régimes actuels qui nous gouvernent.
De même, on ne peut limiter le terme « démocratie » à son acception sociologique, tocquevillienne , d’« état de société », et donc régie par le marché (comme on le trouve dans le texte de Temps critiques). Parler de « démocratie de marché » est, d’une certaine façon, un oxymore (on voit bien l’intérêt de ce pseudo-concept forgé par des sociologues dans les années 60), et ce terme n’a pas grand-chose à voir avec la démocratie politique.
Mais si on revient à l’actualité du rapport entre démocratie politique et capitalisme néolibéral, on a matière à réflexion…
En effet on observe aujourd’hui que les secteurs de la Silicon Valley aux USA, et ici des financiers comme Pierre Edouard Sterin (qui apparemment est dans la finance de ce qui est à la pointe de l’informatisation et du virtuel), soutiennent Trump pour les premiers et le RN pour l’autre, en finançant aussi des officines conservatrices (Périclès par exemple), dont le but est d’infuser une idéologie réactionnaire, et de favoriser une certaine « fascisation » des esprits. Et ces secteurs économiques « de pointe » semblent avoir besoin de régimes politiques autoritaires, qui n’ont rien à voir avec une démocratie même affadie.
On aurait de quoi s’occuper en essayant de démêler ces questions…
Ci joint un lien vers un article qui traite de cet aspect…
https://lundi.am/Dark-Gothic-MAGA-Elon-Musk-la-neoreaction-et-l-esthetique-du-cyberfascisme
Gianni : Fraser n’a pas besoin de définir la démocratie dont elle parle, elle se fonde sur ce qu’on a sous les yeux. Parle d’un processus en cours de montée de l’autoritarisme ; elle note une tendance, voyant que la démocratie représentative devient de plus en plus autoritaire : le constat est banal.
Jacques : Alors elle reconnait un lien entre économie et politique. Le développement des GAFAM, ce n’est pas de l’autoritarisme mais un processus de fusion entre économie politique, technologie et « social ».
André : La fusion existait aussi sous le régime nazi. Elle conçoit la démocratie comme une agora où on discute des questions de société, qui pourrait imposer ses choix à l’Etat. Qu’entend-elle par pouvoir politique ? La Chine, qui a sauvé le capitalisme en 2009, est un pouvoir autoritaire.
Jacques : Le capitalisme n’a pas de nature. La supériorité de son mode de production est sa liabilité, sa fluidité, sa capacité de dépassement dans la conservation, il réactive des formes anciennes (post ou présalariales). Financiarisation : la finance est au premier rang dans toutes les transformations du capitalisme. Aujourd’hui, elle finance tout le secteur capitaliste d’avant-garde.
Larry : Fraser est liée depuis assez longtemps à la New Left Review (revue dominante à gauche, de qualité, avec beaucoup d’ex-trotskistes, jamais d’articles sur l’utopie – au mieux une défense des mouvements de années 60, une nostalgie d’une époque de forts mouvements sociaux). Le soubassement de convictions et perspectives a presque disparu. Pour elle le féminisme est essentiel. Elle considère qu’il existe un monde non capitaliste indispensable au capitalisme (care), que le système a tendance à détruire tout en en ayant toujours besoin. Les luttes pour elle sont dans ce domaine ; celles qui engagent les producteurs sont secondaires (ils sont au bas de la liste, après femmes, noirs, handicapés, etc.). Elle promeut l’idée d’une alliance entre toutes ces forces. Or si en 2017 il y a eu des manifs importantes contre l’investiture de Trump, aujourd’hui, rien. Ellen Meiksins Wood est à l’origine de l’idée de séparation entre politique et économique, qui concorde selon elle avec la sortie du féodalisme.
Jérôme : Il y a plusieurs conceptions de démocratie. La question est le lien entre capitalisme et démocratie. Le capitalisme est devenu démocratique en réponse à des luttes, il a dû accepter une forme limitée de démocratie, compatible avec ses intérêts. Le problème : quelle démocratie radicale pourrait remettre en cause le capitalisme ? Le capitalisme néolibéral est différent du capitalisme libéral : il a utilisé l’État pour des formes lui permettant de se reproduire.
Jacques : Dans l’article, il est question de « crise de la démocratie ». Oui, il y a crise de la démocratie bourgeoise, mais ça ne va pas forcément vers l’autoritarisme. Les institutions sont en train de se défaire de leurs formes autoritaires (école, armée, justice…), on va vers plus de laxisme, de fluidité, d’arrangement, de nouvelles procédures… La loi n’existe plus, il n’y a plus que de multiples petites lois et règlements : est-ce que c’est de l’autoritarisme ? Il y a fusion dans une société capitalisée : tout est inséré dans un fonctionnement assurant une emprise. Et ce n’est pas extérieur à nous, bien d’accord avec Fraser là-dessus. Fraser pense qu’il y a des résistances, mais le logiciel libre est bien le produit de ce monde, qui offre des alternatives à nos défaites.
Jérôme : Le capitalisme reconfigure plutôt d’anciens modes autoritaires. L’autorité n’a pas disparu de l’école, loin de là.
Nicole : Le problème dans cette idée que le capitalisme se renouvelle en absorbant les contestations et dépassant ses contradictions, c’est qu’on ne comprend plus très bien ce que recouvre l’idée de « crise ». Or le « capitalisme », qui n’est qu’un ensemble de forces parfois contradictoires, a pour les moins des points de faiblesse. Crise écologique, une crise de légitimité du système…
Jérôme : Oui, il y a une crise de légitimation du capitalisme, et il s’agit de comprendre pourquoi. La crise écologique, elle pèse, car le capitalisme ne peut s’abstraire des limites de la planète.
Marcel : La crise désigne un moment précis. En ce sens, le terme de « crise écologique » est réducteur.
Jacques : Inapproprié plutôt, car il induit une projection de ce qui va arriver. Or c’est dans le moment de la crise que la crise se repère. Nous ne sommes pas dans un moment de grande crise, comme en 29, où la réaction est immédiate.
Nicole : Et il n’y a pas une crise de rentabilité du capital ?
Larry : Avec l’IA on ne sait pas comment ça va évoluer. La rentabilité ? On est à la veille d’un grand bouleversement, qui peut se traduire par la stagnation ou le décollage. La réorganisation technologique en cours aux USA se fait autour du pouvoir avec des gens de 40-45 ans, des non-héritiers (pas oligarchiques). Il y a eu récemment une sorte de conclave à Washington sur les voitures électriques : Tesla, le seul constructeur, était absent. C’était le capital oligarchique qui était réuni là, des dynasties, qui avaient touché un fric monstre pour être sauvées. On a, il va y avoir une concurrence âpre avec la Chine, et ceux qui arrivent au pouvoir aujourd’hui ne se racontent pas d’histoires, ne sous-estiment pas leur adversaire.
Anne : Sur France Culture, une émission récente sur la mondialisation et la Chine.
Mohamed : Pourquoi cette extrémisation du débat politique, cette impression de guerre civile à venir aux USA ? Comment vont agir des sociétés (mines, pétrole) qui ont poussé Trump et le Parti républicain au pouvoir ? On a fait un peu vite la comparaison avec la période précédant le nazisme, mais…
Jacques : C’est essentiellement du pragmatisme. De la part d’anciens libertariens (leur action a été saluée y compris par des gens de gauche). Pas forcément les mêmes fractions. Le Parti démocrate n’a rien à leur proposer d’autre, ils peuvent donc se rattacher à un pouvoir assez musclé. Actuellement, une plus grande liberté est offerte au secteur censé porter la concurrence au niveau mondial. Après ça va faire naître une contradiction au sein de ce groupe-là, qui est déjà près d’éclater sur la question du protectionnisme. Une alliance s’est formée qui n’est pas stable. Idem sur l’immigration. En plus, Wall Street s’est prononcé contre Musk : les grandes banques sont contre Trump. Les financiers n’ont pas les mêmes attentes que le bloc au pouvoir. L’administration américaine a elle aussi un poids, qui défend aussi des intérêts.
Mohamed : Amazon a décidé de fermer ses entrepôts dans la province du Québec, parce qu’un syndicat s’y est monté.
Jacques : Mais Amazon a monté le salaire minimum à 15 dollars dans plusieurs Etats du Sud des EU (contre anciennement 7,50 dans le Texas). Le prix de la force de travail pour les forces productives dominantes du capital n’est pas un problème.
Pierre-Do : Les indicateurs d’Emmanuel Todd sont intéressants, même si on les entend moins. Le groupe coalisé autour des technologies de pointe. Todd dit qu’au niveau de la formation, il y a un nombre croissant d’Américains qui se destinent au droit, à…, et que ça va se casser la gueule. Concurrence de la recherche chinoise.
Jacques : Mais les USA captent les savoirs produits ailleurs, ils continuent à attirer les cerveaux. Ce qui leur donne une puissance que la Chine n’a et n’aura probablement pas. Voir aussi l’immense puissance du dollar. Les USA sont le seul pays qui a une marge de manœuvre importante (élever les taux d’intérêt ou pas). Il est aussi celui qui a le plus d’autosuffisance, même s’il est dépendant des flux financiers. La Chine ne crée pas de marché intérieur.
Larry : Le plat dominant dans toutes les régions de France, c’est désormais le burger…
Anne : Un certain nombre de pays sont en train d’échapper à l’emprise du dollar. C’est encore minoritaire, mais…
Mohamed : Il y a au moins dix ans de cela, certains tenaient déjà ce même discours.
Larry : Ça fait un quart de siècle que Todd prédit le déclin imminent des USA…
Jérôme ; Une grande partie des classes populaires qui ont voté pour Trump ont un autre discours sur l’immigration. Elles ont été dévastées par l’économie libérale. Admettons que Trump réussisse… les tensions vont sortir. A qui va profiter la politique de Trump ?
Marcel : Les ouvriers qui ont voté Le Pen ont eu l’impression qu’une certaine gauche mettait l’accent sur les différenciations sociales en oubliant les problèmes économiques et les souffrances induites.
Jacques : La situation la plus grave, c’est l’Allemagne. Le pays le plus industrialisé d’Europe va dans le mur. Des zones entières ont des infrastructures dans un état déplorable. Rien ne fonctionne parfaitement, les trains sont en retard et en cas de problème on laisse les voyageurs se débrouiller tout seuls. Dans certaines concentrations ouvrières, une sorte d’anticapitalisme basique se développe qui porte les gens à voter Afd. Et cela ne touche plus seulement l’ancienne partie Est du pays comme depuis 20 ans mais la partie Ouest et particulièrement celle de la Ruhr dans laquelle l’industrie allemande repose sur l’aristocratie ouvrière, qui est touchée de plein fouet par le déclin. Une enquête faite à Bochum auprès des ouvriers de l’automobile (la plus grande usine Opel d’Allemagne) en atteste (cf. Libération du O5/ 12/2024 et Le Monde du 5/01 2025). Tous les investissements allemands sont allés sur ce qui s’avère être des points faibles dans le nouveau développement.
Catherine : La question des taxes qui vont être imposées à leurs produits va accentuer la crise.
Mohamed : L’ordolibéralisme, cette forme de gestion du capitalisme, s’avère un échec.
Jacques : L’Allemagne et le Japon n’ont pas reconnu le marché financier. Leurs industries étaient liées aux banques, dans un climat de confiance réciproque. Mais avec la mondialisation les marchés bancaires se sont montrés insuffisants et prudents sur l’offre de crédits. Comme le marché financier comporte une perte en termes de sécurité, l’Allemagne a choisi de continuer sur l’ancien mode de financement et a résisté à la domination du marché financier. Capitalisme de papa. Conséquences : ils ont été obligés de changer car les banques allemandes ne sont pas assez fortes pour se passer de ce marché financier. C’est Merkel qui a montré la voie. S’il n’y avait pas eu Merkel au moment de la crise sanitaire, il y aurait eu un risque important de révolte en France dans la foulée des mouvements sociaux récents en France. Avec Macron ils ont fait une alliance et la banque centrale européenne a inondé l’Europe de liquidités. En Allemagne, ils ont traditionnellement les mains liées par la Cour de Karlsruhe pour les questions budgétaires et monétaires, mais Merkel a réussi à imposer son choix.
Mohamed : Ils ont ouvert les cordons de la bourse avec les GJ et le Covid, mais ils sont en train de nous le faire payer. Au total c’est toujours à la société de payer.
Jacques : C’est ce discours de gauche qui a délégitimé toute la gauche. Dire que finalement le capital récupère tout en dernier ressort est profondément démobilisateur. Ce n’est pas ça qui compte. Beaucoup de ceux qui ont voté pour Trump l’ont fait parce que les prix avaient augmenté.
André : Pour l’Allemagne, il faut prendre en compte le cadre géopolitique.
Mohamed : La guerre en Ukraine a pesé sur le commerce allemand. En Tunisie on a crevé de faim pendant le Covid.
Jacques : Si tu n’as pas la rapidité des transports, toute la logistique nécessaire, fournir l’alimentation… Dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, s’il y a à un endroit où ça coince, rien n’arrive. Cf. la pénurie de moutarde de Dijon, dont on a appris qu’elle venait du Canada.
Nicole : La France, qui a poussé très loin sa désindustrialisation, se porte-t-elle mieux que l’Allemagne ?
Jacques : Dans le cas de l’Allemagne, tout converge pour qu’il y ait un choc (et les chocs en Allemagne…!) : elle a peu d’amortisseurs sociaux, pas de politique du logement, de gros problèmes sur ses infrastructures. En France, il y a eu une préparation : la « start up nation » de Macron est une réaction, la BPI, qui est une sorte de banque d’Etat, est faite pour diriger l’investissement, cibler, prendre des risques. En France, le secteur le plus puissant est externalisé : les grandes entreprises françaises sont actives à l’extérieur. Aujourd’hui, plus une entreprise est forte à l’extérieur de son pays d’origine, plus le problème du rapatriement des profits et de leur orientation est important. Ça peut être un problème, et c’est pourquoi l’Etat envisage d’augmenter spécifiquement l’impôt sur les sociétés, pour ces grands groupes. Mais au niveau européen, c’est la Commission européenne qui a empêché la formation de monopoles européens (ils sont en train de s’en rendre compte) avec sa stratégie sur les salaires : ne pas les augmenter, mais accroître le pouvoir d’achat par la baisse des prix. Or baisser les prix en renforçant la concurrence comme si elle était principalement intra-européenne a empêché la formation de ces monopoles européens. Par ailleurs, il y a quand même en France une certaine capacité de lutte ou au moins de résistance, pas seulement historique, mais si on regarde la période 2017-2023 qui laisse des espoirs.
André : Pour quelle perspective ?
Jacques : Il y a des mouvements de réaction (ex. : GJ) et d’autres de refus porteurs d’une perspective d’autre société. De mon point de vue (et là je rejoins Henri Simon), la lutte de classe est une lutte de tous les jours, contre les chefs, les abus… Le fait de réfléchir, de ne pas se laisser submerger par les choses, de ne pas sombrer dans l’immédiatisme. Pour moi la question du programme, c’est fini. Si elle se poursuit, c’est dans une espèce de nébuleuse (LFI, Lordon, etc).
Jérome : Dans les textes de Temps critiques, on a l’impression que toute espèce d’antagonisme a disparu. Fraser, malgré les manques de son analyse, essaie d’entreprendre une analyse critique du capitalisme et de repenser un mouvement antisystémique. Dans cette phase où il y a de la colère, qui va leur montrer la direction ? De quel côté ça va tomber ?
Jacques : Avec les Gilets jaunes et contrairement à ce qui a été affirmé au début par les forces de gauche, le danger principal ce n’était pas que la droite reprenne le mouvement puisqu’elle est fondamentalement pour l’ordre. Le mouvement en reprenant la référence à la Révolution française a bien vite penché à gauche … au risque de sa récupération intéressée (l’idéologie syndicale actuelle de la convergence).
Il ne faut pas refuser de rejoindre un mouvement sous prétexte qu’il ne correspond pas à notre schéma préconçu. A Lyon, on a participé au mouvement, avec des AG de 700 à 500 personnes au début. Dans cette assemblée on a prôné le refus de la représentation. On a réussi à ce que les délégués à Commercy n’aient qu’une voix consultative. On a réussi à empêcher la dissolution des assemblées par substitution par un système de commissions prôné par d’anciens Nuit debout. Je suis peu intervenu dans l’assemblée, mais j’y ai quand même soutenu l’idée que « c’est le mouvement qui fait l’assemblée et pas le contraire », alors que dans la forme assembléiste, le risque est que l’assemblée pense diriger le mouvement. Or le mouvement débordait régulièrement de ce qui était décidé en assemblée. Cette forme d’intervention politique initiée par 4 « lyonnais » de Temps critiques autour de ce que nous avons appelé « le journal de bord » (un groupe fluctuant et hétérogène de 30 à 50 personnes de la région dont certains non urbains) n’a pas été considéré comme un groupe extérieur aux Gilets jaunes, mais a été, du fait de sa participation aux actions quotidiennes, intégré à la coordination Lyon et région des GJ qui prenait des décisions.
Quelques précisions par rapport au CR
1) Dans l’exemple de la politique européenne vis-à-vis du processus de concentration en général et plus particulièrement quant aux fusions/acquisitions, j’ai pu donner l’impression de critiquer la « main visible » des institutions de l’UE en négligeant de mentionner que c’est souvent par manque d’unification plutôt que par trop que pêche une politique européenne… du point de vue du capital. Ainsi, si les entreprises du CAC 40 sont plus tournées vers l’extérieur que l’intérieur, c’est que les droits de douane internes y sont très élevés (45% pour les produits industriels, 110% pour les services). Ce caractère national plus important que résiduel concerne aussi des banques trop orientées vers le financement interne (de leur propre État, de l’immobilier et des secteurs traditionnels) ; l’épargne et les investissements se tournent vers l’extérieur. C’est particulièrement dommageable (toujours du point de vue du capital) quand cela se produit dans un pays comme la France qui n’a pas activé de fonds de pension et dont l’épargne s’éparpille (caisse d’épargne, assurance-vie) plus qu’elle ne se concentre des projets industriels.
De ces faits, la concurrence interne plutôt que les accords d’acquisition ou de fusion pousse plutôt les salaires vers le bas et/ou la stagnation avec pour résultat une demande atone.
2) Je voudrais revenir aussi sur l’intervention de Monique qui, telle qu’elle figure dans le CR, a été considérablement allongée post-réunion. Elle y reprend notamment la notion d’oligarchie dont je n’ai pu parler dans le débat lui-même puisqu’elle n’y a pas été discutée.
En tout cas,dans Temps critiques, nous en avons entrepris la critique il y a près de 20 ans (cf. JW : « Reproduction, système, oligarchie » in n°14, 2006 ; B. Pasobrola : « Le retour en grâce du mot oligarchie » et in n°16, 2012) et le cours de l’histoire de ces deux décennies ne semble pas nous avoir démentis à ce sujet.
Aristote dans LaPolitique lui avait donné sa source historique, mais à contre-emploi du sens courant actuel et sans aspect critique : « Ainsi la voie du sort [tirage au sort] pour la désignation des magistrats est une institution démocratique. Le principe de l’élection, au contraire, est oligarchique (…) L’aristocratie et la république puiseront leur système, qui acceptera ces deux dispositions »… pourvu qu’elles s’appuient sur une grande classe moyenne stabilisatrice. Mais c’est Castoriadis qui l’a actualisé et lui a donné sa perspective critique à partir du moment où abandonnant l’analyse strictement classiste, il a développé l’idée d’une nouvelle séparation/domination entre dirigeants et dirigés dans l’entreprise comme dans la vie politique. Une perspective qui restait révolutionnaire malgré un changement de cap. Si Lefort s’est raccroché à la démocratie vraie et Abensour à la démocratie contre l’État, comme antidote aux tendances oligarchiques, Castoriadis semble avoir placé ses espoirs dans l’autogestion (cf. sa participation, comme Mothé, à la CFDT de l’après 1968).Mais la référence à l’oligarchie et sa critique restaient le fait de petits cercles, alors qu’aujourd’hui, elle fait consensus critique pour tous les courants politiques de gauche et de droite qui la dénonce de façon plus morale que politique.Le fait que le terme soit utilisé pour désigner aussi bien la situation aux États-Unis qu’en Russie ne semble gêner personne, en tout cas pas les médias (cf.
https://www.lemonde.fr/idees/article/2025/02/12/l-oligarchie-une-elite-argentee-et-dominatrice-au-pouvoir-de-moscou-a-washington_6543101_3232.html).
Or, dans notre hypothèse théorique et critique, s’y référer est devenu inopérant et peu probant, d’une part par la restructuration de l’État sous sa forme réseau, qui tend à se substituer à sa forme nation (ce que méconnaissent les utilisateurs de la notion) et ses conséquences politiques (crise de la représentation et de la démocratie) ; et d’autre part par le processus de globalisation (financiarisation de l’économie et capitalisation de toutes les activités humaines), de sorte que, en tendance, c’est plutôt vers un « tous oligarques » que porte le mouvement du capital ! Une sorte d’oligarchisationmoyenniste des rapports sociaux… À noter que cette formulation de JG résonne comme en écho avec la condition émise par Aristote en son temps.
S’il y a un tel « bombardement » du mot, c’est qu’il contient, en creux, une conception classiste de la société (et que donc cela convient aux marxistes vulgaires, aux démocrates comme aux souverainistes/populistes de droite et de gauche1), une conception selon laquelle il y aurait un petit nombre de « possédants » (comme on disait au XIXe siècle) ou d’ultra-riches, dit-on aujourd’hui,et une masse d’exploités ou de dépossédés, etc.
On reconnaît là le slogan inconsistant (voire inepte) des Occupy Wall Street, décuplé aujourd’hui par l’arrivée au pouvoir de l’équipe Trump/Musk.
[Note complémentaire de Larry C. : Une partie de la gauche américaine met depuis plusieurs années l’accent sur l’importance de ce que d’aucuns ont pu nommer la Professional Managerial Class, en gros, les cadres supérieurs/professions intermédiaires, pour qui le passage par l’enseignement supérieur va de pair avec des revenus tout aussi supérieurs. C’est, d’après l’historien Adam Tooze, l’hostilité du petit peuple envers ces couches-là, plutôt qu’envers les grands patrons, qui explique en grande partie la polarisation politique actuelle des États-Unis et le vote populaire pour Trump. Cette thèse n’est pas sans poser des problèmes, mais à tout prendre, je le préfère à la rengaine sur le 1 % et, a fortiori, sur les oligarques qui, soudain, se seraient accaparés d’un pouvoir auparavant entre les mains de… de qui au fond ?]
JW
J-L. Mélenchon : « Le peuple détrônera la petite oligarchie des riches. (…) Du balai ! » (L’Ère du peuple, Pluriel, 2017 [↩]
Publication d’un numéro #29 d’Interventions intitulé : La critique démunie.
Le résultat des élections américaines ou la nécessité d’aller au-delà des idées convenues. Texte disponible à la lecture sur notre site à l’adresse https://www.tempscritiques.net/spip.php?article548 et aussi en brochure A5 sur ce lien.
Il nous semble toujours nécessaire, du point de vue théorique comme dans des perspectives de lutte, de faire ressortir le fait que le capital est avant tout un rapport social de forces en interaction dialectique qui toutes participent, certes à des pôles différents (capital, travail, État), de sa reproduction ; et non pas un « système » essentiellement abstrait régi soit par des automatismes dont les agents ne seraient que des fonctionnaires impersonnels (cf. la notion de « capital-automate » qu’on rencontre parfois chez Marx puis Bordiga), soit par des forces plus ou moins occultes tirant les ficelles (finance, « banque juive », franc-maçonnerie, etc).
Dans cet ordre d’idées, nous vous proposons ici un compte rendu d’une réunion débat organisée le 17 décembre 2023 par le groupe de discussion et de rencontre « soubis » autour de l’article de Larry Cohen : « Victimes, complices ou acteurs de premier plan ; le rôle des États dans le tournant dit néolibéral » paru dans le numéro 22 de Temps critiques (automne 2023).
SouBis – Compte rendu de la réunion du 17 décembre 2023
Débat avec Larry Cohen sur son article paru dans Temps critiques n° 22, « Victimes, complices ou acteurs de premier plan ? Le rôle des États dans le tournant dit néolibéral »
Larry : Pourquoi j’ai écrit cet article ? Je suis tombé par hasard sur l’article de Jack Copley [auteur du livre Governing Financialization, sur le Royaume-Uni], qui m’a intrigué : je pourrais jeter trente ans de Monde diplomatique car son discours sur le tournant néolibéral est faux. Tournant oui, mais pas la forme exposée jusque-là. Donc je me suis proposé d’approfondir le sujet, sachant que les auteurs qui ont écrit sur le sujet l’ont tous fait en anglais ou en allemand. La question qu’il y a derrière, c’est : quel est le rôle de l’État dans l’économie capitaliste ? En France le débat sur ce point s’est peu ou prou éteint après Poulantzas. Se focaliser sur les USA et la Grande-Bretagne est justifié, car ces deux pays ont été les premiers à faire ce tournant, et aussi compte tenu de l’impact mondial des USA et l’impact de la politique de Thatcher.
J’ai découvert dans ces livres que curieusement le travail idéologique de préparation par les courants néolibéral ou ordolibéral existait bien, mais que ce n’est pas ce qui a enclenché le mouvement. Et que ce ne sont pas les banques non plus. Tout s’est joué au niveau des États. Daniel a dit dans un de nos débats que Castoriadis n’avait pas voulu voir à quel point l’économie capitaliste s’était imposée et n’avait voulu voir que le poids du rôle de l’État. Mais Castoriadis n’avait pas si tort que ça. Mes lectures montrent plutôt que les acteurs de ce changement, ce sont les États.
On peut se demander : quel est l’intérêt de le savoir ? Je pense que ce n’est pas anodin ; l’idée que les pauvres États ont subi impuissants la menace des grandes entreprises de délocaliser ne tient pas la route.
Pierre-Do : J’ai été très intéressé par ce texte. L’idée que la responsabilité du tournant néolibéral de l’économie capitaliste provient essentiellement des grandes entreprises, du secteur bancaire, des idéologues néolibéraux, c’est aussi une manière d’évacuer la question de la responsabilité politique de l’Etat. L’économie capitaliste demande avant tout deux types d’action à l’État : d’une part de favoriser l’extraction de la plus-value en assurant des conditions optimales à sa reproduction : transports, santé, éducation, aides et subventions publiques au secteur privé en cas de difficultés ; d’autre part de s’immiscer le moins possible dans l’économie. Dans le contexte de la mondialisation du marché et des échanges, et ultérieurement du déficit des dépenses publiques en Europe de l’Ouest, l’État dit « surchargé » a cherché, pour résister à la double pression du marché et de la pression sociale, à s’alléger politiquement en se plaçant volontairement sous la contrainte d’organismes supranationaux, OMC, FMI, UE… et au niveau micro-économique en initiant graduellement : privatisations, réforme des systèmes de retraite, de santé, d’éducation. Tout cela en tentant d’éviter l’affrontement social massif. En dernier ressort est posée la question de la légitimité de l’État. C’est bien l’État qui décide, dans le cadre contraint auquel il a volontairement consenti, de la redistribution des richesses, des aides aux secteurs de l’économie capitaliste qu’il souhaite favoriser. Enfin l’État possède l’appareil coercitif pour faire appliquer les mesures prises en particulier les plus socialement funestes.
Larry : Selon les auteurs canadiens que je cite, Panitch et Gindin, casser le mouvement ouvrier américain était encore plus important que casser les mouvements ouvriers européens. La défaite de la grève des aiguilleurs du ciel a ouvert les vannes qui ont permis aux entreprises de négocier les salaires et les conditions à la baisse. Pourquoi aux USA ? Parce qu’ils représentaient encore 25 % de la production capitaliste globale.
André : Oui, il me semble que c’est bien ce qu’il faudrait comprendre, pourquoi les luttes ouvrières deviennent si violentes au tournant des années 70-80, qu’est-ce qui explique le basculement néo-libéral ? L’idée d’un État qui n’est pas la marionnette des grandes entreprises m’a intéressé. Mais ton argumentation part sur deux des grands thèmes des années 80-90 : la critique de la mondialisation et celle de la financiarisation. Pour la financiarisation, tu dis : le manque de rentabilité des entreprises, la baisse de leur taux de profit, a poussé celles-ci à placer dans la sphère financière l’argent qu’elles n’avaient plus intérêt à investir dans leurs propres activités, thèse défendue par beaucoup d’économistes. D’après toi, cette baisse serait due aux taux d’intérêt très élevés. Mais la mise en place de cette politique monétaire par le président de la réserve fédérale Paul Volcker pour lutter contre l’inflation arrive après cette baisse du taux de profit. La très nette baisse du taux de profit s’observe sur la période 74-75 jusqu’à 80-82 en Grande-Bretagne et en France, peut-être un peu plus tôt aux USA. Dans ton article la politique monétaire occupe une grande place, tant dans le cas de la financiarisation que dans celui de la mondialisation. Je pense qu’à tout le moins c’est discutable.
Larry : Ce n’était pas mon propos d’expliquer la baisse du taux de profit. La concurrence grandissante subie par les USA, qui a mis à mal leur domination de l’économie mondiale, a fait que les marges bénéficiaires ont rétréci (les capitalistes n’aiment pas beaucoup la concurrence en fait). Cela explique donc pourquoi les entreprises étaient en difficulté, mais pas leur orientation vers la finance. Greta Krippner [autrice de Capitalizing on Crisis, sur les USA] a pu s’entretenir longuement avec les acteurs de l’époque. Les pays développés ne pouvaient pas assumer les taux d’intérêt de 20 % atteints aux USA sous l’effet de la politique anti-inflationniste de la Réserve fédérale sous Paul Volcker. La fronde contre cette politique de taux élevés de dollar fort a été menée par la Business Roundtable, dont le texte a été rédigé par le patron de Caterpillar, qui a presque demandé : « Vous voulez désindustrialiser notre pays ? » Avec un dollar fort on n’arrive pas à exporter, mais avec un taux d’intérêt élevé c’est intéressant d’investir dans des outils financiers.
André : On peut également discuter le point de vue que tu adoptes : l’État a en main les instruments monétaires (keynésianisme). Il est intéressant de prendre la thèse d’autres économistes comme Michel Husson ou ceux de la théorie de la valeur pour qui le tournant néolibéral est le produit d’une crise structurelle du capital. L’industrie automobile n’est plus rentable. La survaleur extraite est insuffisante. Pourquoi les luttes sociales en Grande Bretagne devenaient-elles aussi violentes ? Durant les années 70, les travaillistes cherchent à sortir de la crise, c’est-à-dire à restaurer un taux de profit suffisant, et n’y arrivent pas. Ce seront ces nouvelles politiques dites néolibérales qui vont permettre le rétablissement des taux de profit à leur ancien niveau (cela au détriment des rémunérations, de l’emploi, des conditions de travail, des solidarités nationales, des services publics). Je pense qu’il est important de discuter de ces thèses, car selon l’explication que l’on a de ces crises, la critique et les luttes dans lesquelles on s’engage peuvent être très différentes.
Pierre-Do : Il y a un ajournement continuel de la crise structurelle du capitalisme. Cette crise n’a pas l’effet décrit par la théorie marxiste. Car le capitalisme continue à fonctionner pas trop mal. Il y a eu déplacement de la lutte de classe vers une lutte fiscale (« lutte des taxes ») dans les années 80-85.
Larry : James O’Connor a écrit au début des années 1970 que c’était ce qui se profilait. Ce que dit André ne contredit pas ce que je soutiens. Les États ont agi sous l’effet d’une pression objective : le gâteau à répartir avait rétréci. Si les États avaient agi autrement, je ne sais pas quelle forme la crise aurait pris. Je veux seulement mettre en avant des aspects sous-estimés à gauche.
André : Je trouve très intéressante ta thèse principale, le fait que les politiques menées ne sont pas dictées par tel ou tel pouvoir occulte. On constate que les gouvernements ont très peu de marge de manœuvre. La même politique se met en place partout, par des gouvernements de droite comme de gauche.
Larry : Une voie a été essayée mais pas prise au sérieux par des gens comme nous, celle préconisée par l’union de la gauche, qui était une autre façon de réagir. Est-ce qu’il était possible de convaincre le gouvernement allemand de faire cause commune sur cette base ? S’il avait refusé le tournant néolibéral, on ne sait pas ce qui se serait passé.
Pierre-Do : En 1981 la gauche dite « plurielle » n’aurait eu aucune chance de succès en proposant une politique économique néolibérale. Plus tard Mélenchon, pour se faire élire, faisait essentiellement des propositions de redistribution différente de la richesse sans toucher aux fondements du système capitaliste.
Gianni : Tu dis qu’à l’origine du tournant il y a à la fois la crise fiscale de l’État et une baisse de la productivité qui les empêchent d’ouvrir les cordons de la bourse pour acheter la paix sociale. Mais un aspect des choses me laisse perplexe : l’endettement des États ne baisse pas, il y a seulement redirection de l’investissement public vers d’autres investissements, avec recours à la répression une fois qu’on ne peut plus acheter la paix sociale. La révolution informatique a supposé d’énormes investissements de la part de l’État ; or ces investissements ont coupé l’herbe sous les pieds aux salariés, donc sapé les rapports de force qui leur permettaient d’obtenir des avancées – rendant les salariés « inessentiels », pour utiliser le vocabulaire de Temps critiques. Tu n’abordes pas cette question.
Pierre-Do : L’endettement et le déficit public : on vient bien comment c’est devenu une méthodologie de gestion de l’État. Il y a mise en avant constante d’une contrainte présentée comme supranationale. Contrainte établie par l’UE à partir de ce qu’Alfred Sauvy avait écrit en 1952sur le niveau de déficit qui permettrait d’avoir une gestion saine des finances publiques. Les 3 % sont devenus un dogme, constamment remis en question mais maintenu comme ligne de conduite, et utilisé par l’Etat pour justifier les privatisations par exemple. Le prix ridiculement bas de l’action France Telecom mise en vente par l’État, c’était une façon d’accoutumer les gens au système boursier et par là de dévier la colère sociale. L’ajournement de la dette structurelle se fait à travers un certain nombre d’artifices. Point intéressant dans l’article : l’importance de l’adhésion de la population à ces programmes. Au bout d’un moment, c’est le public qui devient cogestionnaire. Il a le sentiment de faire un choix devant une offre de services, que ce n’est pas l’État qui l’impose. Bien sûr il faut avoir obtenu auparavant un consensus public, une intégration idéologique de secteurs entiers de la population au système.
Nicole : Sous le « néolibéralisme », il y a eu aussi une transformation de la nature de l’État. En France, la décentralisation a beaucoup transformé le paysage politique, avec des décisions qui se prennent désormais à niveaux multiples, et pas toujours de façon cohérente, mais qui impliquent bien plus la population notamment à travers le tissu associatif.
Larry : C’est ce que Temps critiques appelle l’État-réseau. Jusqu’où va l’État ? Il y a à ça une dimension technique, mais il est plus intéressant de comprendre ce que ça implique socialement. C’est appuyé par une partie de la population, militante pour une partie d’entre elle. Exemple avancé par Todd : dans son coin de Bretagne, une soixantaine de personnes sont mobilisées pour aider une seule famille de réfugiés ; on pourrait penser que ce devrait être la tâche de l’État. Cette évolution vers l’État-réseau représente aussi une manière de répondre aux attentes de la population. En 2015 en Allemagne, les associations caritatives ont été débordées par les demandes des citoyens volontaires pour accueillir la vague des réfugiés. L’argent public est là, mais l’action est faite par d’autres agents que l’État.
Jackie : La décentralisation, c’est quand même un phénomène franco-français.
Monique : C’était une revendication sociale en raison de la grande centralisation du pays héritée de l’histoire. La gauche s’est fait plaisir idéologiquement en la mettant en œuvre. Mais l’abondement des collectivités locales par l’État central a toujours été insuffisant. Et la gauche a largement participé à ce phénomène.
L’idée que l’État est une marionnette aux mains du capital ne tient pas la route dès que l’on se renseigne un peu. Même chez Adam Smith il est expliqué que, pour que le marché fonctionne, il faut un État qui crée des structures juridiques adaptées. Balancer l’État, c’est l’idée des libertariens (Rothbard). Même Marx lorsqu’il analyse la Commune reconnaît une certaine autonomie de l’État. Le pouvoir des entrepreneurs est réel, mais ils n’ont pas de force de frappe. La répression est la tâche de l’État. L’État démantèle les services publics et assure la répression.
Il y a une chose que je n’ai pas bien comprise : pourquoi à la fin des années 70 il y a une rupture fiscale ? Je me souviens d’une période où la dette publique n’était pas une obsession. Le dogme de la dette est apparu au début des années 80.
Larry : C’est un problème européen plus qu’américain. L’Allemagne a l’obsession, pour des raisons historiques, de la stabilité financière et économique. Mais cela n’est pas pire que la méthode italienne qui consistait à distribuer de l’argent ici et là puis de temps en temps à dévaluer la monnaie. Streek dit qu’un pays peut choisir d’opter pour l’équilibre économique ou pour l’équilibre social – en gros, la division entre l’Europe du Nord et l’Europe du Sud. La France est en position intermédiaire. Depuis les années 80, on ne compte pas les gouvernements qui ont voulu réduire ceci ou cela. La France est plutôt du côté des pays égalitaires. Certes on va dans le sens de l’inégalité, mais depuis vingt-cinq ans. Rien à voir avec ce qu’ils se sont permis aux USA et en Grande-Bretagne.
Henri D : Les États sont intervenus massivement pour sauver les banques en 2008, au détriment de la population. L’État est bien au service des puissants.
Larry : Oui, mais ils l’ont fait surtout pour maintenir l’équilibre du système. Il fallait sauver les banques. Pendant la crise des subprime, la Réserve fédérale a ouvert avec l’UE une ligne de swaps de devises donnant accès à une quantité quasi illimitée de dollars. Sans ça, on aurait eu une crise bien pire que celle de 1929. Et ils ont en grande partie réussi. Le niveau de vie a baissé, certes, mais ce n’est rien par rapport à ce que c’était en 1929. Un de mes profs de lycée aux USA, fils de paysans du Sud profond, évoquait une armée de gens venue quémander du travail sans salaire, en échange d’un repas pour la famille.
Henri S : Il y a une question centrale, à savoir le déséquilibre dans la loi de l’offre et la demande, quand l’offre ne répond pas à la demande. Le taux d’inflation est la pomme de discorde de tout le système. Tous les États font des efforts pour la contrer.
André : Wolfgang Streeck que tu cites avait publié dans Le Monde diplomatique en 2008 un article décrivant les diverses politiques mises en place depuis le début des années 70 pour tenter de résoudre la crise tout en achetant la paix sociale. L’endettement explose à partir des années 80. La première manière d’acheter la paix sociale, dans les années 70, c’est l’inflation, mais ça ne marche pas. La politique néolibérale se met alors en place, lutte contre l’inflation, envol de la dette publique. Vu l’ampleur prise par la dette, l’État cherche à en faire porter le poids par le public en desserrant fortement les règles encadrant le crédit aux ménages ; la crise des subprime en découle.
Larry : Les auteurs canadiens disent que l’offre de crédits immobiliers à des gens aux très faibles moyens ne peut se comprendre sans tenir compte de la stratégie d’intégration de la classe ouvrière par la propriété : le cadre est idéologique au moins autant qu’économique.
André : Idem pour les participations au capital des entreprises proposées aux salariés.
Larry : A la fin des années 50, on était encore dans un niveau de vie très bas. L’endettement des États, au fond, je m’en fous. La dette américaine des années Reagan et après était astronomique et ils ont réussi à l’endiguer.
Henri S : La pandémie a limité la production, donc l’inflation.
Larry : Je voudrais revenir à un aspect qui m’est cher car il rejoint un débat qui a eu lieu à Socialisme ou Barbarie. Habermas parlait de crise de légitimation – on n’est pas très loin des thèses de Castoriadis. Il disait que c’est le succès même de ce type de capitalisme qui va faire perdre de sa légitimité au système ; or ça ne s’est pas produit à l’époque, comme n’ont pas manqué de le signaler des critiques comme Perry Anderson, de la New Left Review. Mais je pense que cette délégitimation du système, on est en train de la vivre maintenant. Il y a dans l’air un anticapitalisme certes superficiel, mais qui traduit une certaine perte de légitimité des institutions. Les défenseurs du marché se font très très discrets depuis 2008.
André : Musk réclame moins d’État.
Nicole : Dans une conception devenue commune aujourd’hui au moins à gauche, le tournant néolibéral est associé à la montée des inégalités. Tu ne dis rien de cet aspect des choses, pourquoi ?
Larry : Mon texte parle très peu de l’actualité. Il y a aujourd’hui la question des inégalités, mais aussi celle des discriminations. Autrefois on disait que toute la classe ouvrière était soumise à l’exploitation, et qu’il s’agissait de la faire progresser ensemble. Aujourd’hui, c’est : que les meilleurs gagnent, qu’ils soient noirs, handicapés ou trans. Le système d’accès aux facs d’élite est accepté aux USA malgré ses inégalités fondamentales, puis dans ces facs on chipote sur la représentation des minorités… Par exemple, Louis Maurin, fondateur de l’Observatoire des inégalités, n’a aucune culture politique qui aille au-delà du keynésianisme. Dans la gauche française, c’est la nostalgie de l’époque keynésienne. Je ne sais pas comment faire comprendre à nos interlocuteurs plus jeunes que réduire les inégalités ne réglerait pas le problème. Quand le gâteau n’est pas en expansion, il y a des choix douloureux à faire. Quand c’est l’État qui les fait, cela comporte un risque politique. Quand ça vient de mécanismes en apparence de marché, comme avec la déréglementation, on peut dire : c’est pas nous, ce sont les taux qui nous l’imposent. Or c’est la Banque centrale et pas les marchés qui gère les taux d’intérêt.
Henri D : Il va y avoir un mur : quand il n’y aura plus de services publics, avec de plus en plus de pauvres, ça va devenir ingérable.
André : Le secteur de la santé représente encore 15% des dépenses publiques.
Gianni : Il y a des dépenses publiques non inflationnistes, notamment les dépenses militaires (pour aider l’Ukraine par exemple). 413 milliards d’euros programmés sur sept ans…
Pierre-Do : Les deux fonctions de l’État : créer les conditions nécessaires à l’accumulation du capital, ce qui a un coût ; et acheter la paix sociale ou organiser la guerre sociale (rôle coercitif). C’est en 68 que j’ai eu le sentiment d’une délégitimation de l’État, puis de nouveau avec le mouvement des gilets jaunes. Il y a eu une lutte des taxes très violente à ce moment-là, avec une violente réponse militaire de l’État. Puis est arrivée la crise du Covid, avec le « quoi qu’il en coûte » et les confinements majoritairement respectés, et l’État s’est appuyé sur de nouveaux outils de contrôle.
Monique : L’éducation fait aussi partie des fonctions de l’État. Or on est arrivé à un point où cela est devenu dysfonctionnel, ça se délite. On ne sait même plus quel type de formation va être utile dans les années qui viennent. Mais surtout, alors que l’éducation nationale servait malgré tout à intégrer les individus, aujourd’hui elle semble être la fabrique des exclus, condamner certaines catégories à être des « superflus », comme disait H. Arendt.
Pierre-Do : il y a une forme de privatisation de l’école, une partie des couches sociales s’oriente vers le privé.
Helen : Aux USA, le fait qu’une bonne partie de la population est sous-instruite ne pose pas problème aux dirigeants. D’ailleurs il y a toute une partie de la population américaine noirs et « petits blancs » pauvres, qui sont exclus, économiquement et socialement, et personne ne s’en soucie.
Larry : Il y a aussi le phénomène d’importation massive de personnel qualifié aux USA. Si un pays peut le faire aux frais d’autres pays, pourquoi payer une scolarité normale aux enfants du pays ? On parle de morts de désespoir aux USA, les taux de drogue et de suicides ont explosé, bien au-delà des ghettos noirs. Mais est-ce que tous les pays peuvent se permettre de jouer là-dessus ? Ce n’est pas évident.
André : Un gouvernement qui ferait le choix d’abandonner l’éducation d’une grande partie de la population me semble d’une grande absurdité, ce serait aller vers une société très violente, la fin de la société. Les gouvernants peuvent-ils dire : on s’en fout ? Je ne le crois pas, je pense que les difficultés du système éducatif relèvent de multiples causes, sociales, économiques culturelles, historiques ; mais pas d’une volonté délibérée d’abandonner l’instruction du plus grand nombre.
Larry : Je ne dis pas qu’un comité central l’a décidé, mais si une entreprise cherche à recruter du personnel compétent et y arrive…
Monique : Ce n’est pas un complot mais une pente vers laquelle ils sont entraînés.
Henri D : On parle de métiers en tension, mais on ne dit jamais que si les boulots étaient bien payés le problème serait résolu.
Larry : Larry : Tout à fait. La question est : à quel prix ? Quand la voirie des villes américaines payaient de hauts salaires, par exemple, personne ne faisait la fine bouche devant ce type d’emplois.
André : Aux USA, il y a un clivage dans la société qui est effrayant. Des dirigeants politiques fous prennent le pouvoir un peu partout…
Larry : Le rôle traditionnel des États-nations n’a pas disparu dans les discours aux USA, Trump peut tenir ce langage. Mais entre la France, la Belgique, l’Allemagne… je ne vois pas quelles sont les tensions qui pourraient alimenter ce discours. Les jeunes européens ne semblent pas avoir une forte identité nationale.
Nicole : Une fois pris en compte le rôle décisif des États dans le tournant néolibéral, quel serait d’après toi le discours anticapitaliste cohérent à tenir aux nombreux « anticapitalistes » avec qui on est amené à discuter ?
Larry : Je me pose cette même question, vu mon expérience récente dans un débat à Figeac. J’essaie de m’adresser à ceux qui veulent renforcer l’État pour parvenir à une situation plus humaine pour leur dire que c’est une illusion.
Gianni : Il faut remettre l’accent sur l’exploitation et sur le fait que le capitalisme est un rapport social.
Helen : Convaincre qu’il faut avoir une vision un peu complexe des choses.
Nicole : Oui, mais la complexité sert aujourd’hui d’argument pour à peu près tout…
Larry : Le discours du type « c’est la finance qui dirige tout » est omniprésent. Même Trotsky, qui se piquait d’être le plus révolutionnaire de tous, ne pouvait pas s’empêcher de simplifier son message en parlant des 200 familles. C’est un problème qui se pose à nous tous ici, de poser autrement la question de l’anticapitalisme, et en des termes compréhensibles.