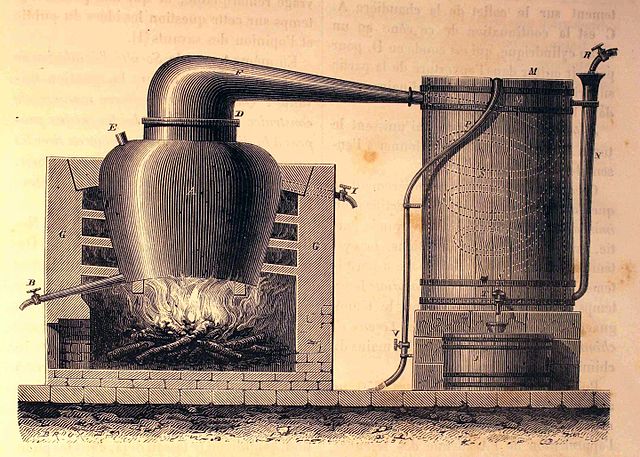A la suite de rapports à la nature, productivisme et critique écologique
L’échange suivant se situe dans la continuité et l’approfondissement des textes publiés sur le blog ou sur le site autour de technologie et capital d’une part et des insuffisances de la critique anticapitaliste d’autre part. Nous proposons ci-dessous l’article Rapports à la nature, productivisme et critique écologique sous une forme enrichie répondant aux remarques de Philippe Pelletier dont le livre est l’un des points de départ de notre critique (Ph. Pelletier : La critique du productivisme dans les années 1930. Mythe et réalités. Noir et rouge, 2016.)