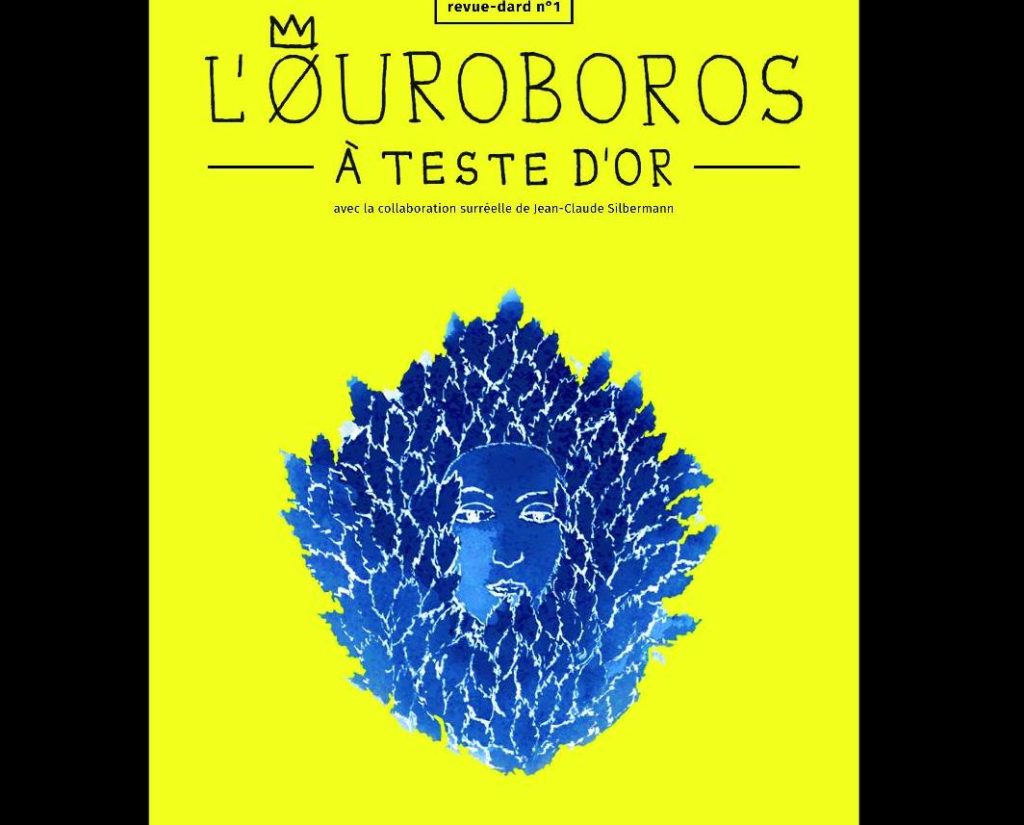À propos des Leurres postmodernes contre la réalité sociale des femmes (Vanina, Acratie, 2023)
Ces quelques remarques ne concernent pas tout ce qu’il y a de bienvenu dans ce livre, et Vanina et moi avons déjà échangé sur ces questions ne serait-ce qu’à la présentation de mon livre Rapports à la nature, sexe, genre et capitalisme à Limoges, à laquelle elle était présente. Pour mes remarques (donc forcément critiques), je partirai, comme base supposée lue par vous tous, du compte rendu écrit établi par le groupe « Soubis » et aussi, bien sûr, de la lecture d’ensemble du livre. Et malgré toutes nos remarques critiques nous conseillons grandement la lecture du livre.
Dans l’introduction au débat, Vanina énonce : « pour moi, tout individu doit être libre de faire ce qu’il ou elle veut faire de son corps — être libre d’en disposer, que ce soit pour le parer, le dévoiler, le cacher ou le transformer », comme s’il fallait marquer son appartenance identitaire au féminisme historique par l’adhésion à un préalable ne souffrant pas de discussion, tout en faisant signe d’ouverture vers certaines tendances néo-féministes (queer en l’occurrence avec l’ajout “transformer”). Or, pour moi, cette affirmation s’avère contradictoire avec sa position critique contre l’individualisme dominant, qui prédomine pourtant dans le reste de son exposé et le livre tout entier. Individualisme produit du capitalisme et de l’idéologie postmoderne qui ne sont vus et critiqués, à travers les exemples de la GPA, de la prostitution, du transhumanisme, de la séparation du « corps », que comme des dérives des tendances néo-féministes, sans remonter jusqu’au fait que le ver était peut-être dans le fruit à cause du présupposé libéral sur la propriété de son corps. Un présupposé qui a certes pu avoir un intérêt heuristique ou en tout cas militant dans le cadre de ce qui se concevait encore à l’intérieur du mouvement plus général d’émancipation de l’époque et au sein de celui-ci, du mouvement particulier des femmes contre le double carcan étatico-bourgeois. Mais plus aujourd’hui que la « révolution du capital » pour moi, la « contre-révolution » pour Vanina, a triomphé et que la « libération » n’a plus pour ennemi cette bourgeoisie et son État (cf. à ce sujet la rupture que représente la thèse de Ch. Delphy sur « l’ennemi principal »). Cette compréhension du sens de la révolution lui fait tout percevoir en termes de « régression » qu’elle oppose à l’époque précédente des « libérations ». Sa lecture de l’époque me paraît trop biaisée par son angle social et classiste où effectivement, de ce point de vue, la défaite est consommée (elle la date de 1980, p. 45). Comme disait à peu près le dirigeant capitaliste W. Buffet, nous avons livré une guerre de classes et nous l’avons gagnée.
Malgré des allusions à la régression sociale, Vanina ne reconnaît pas cette défaite (il ne s’agit pas là de savoir si elle est provisoire ou définitive) puisqu’elle interprète la prédominance d’autres causes (raciales, par exemple) comme « masquant » la lutte des classes (p. 55). Or, si on peut reconnaître, avec Vanina, la lutte des Gilets jaunes comme l’équivalent d’une lutte de classes, elle n’a pas du tout été « masquée » par les luttes particularistes ; elle a été déconsidérée et moquée parce que populaire et illisible selon les canons postmodernes. En effet, les femmes Gilets jaunes pourtant ou parce très nombreuses n’ont pas été féministes, mais Gilets jaunes ; il a fallu les magouilles de l’assemblée des assemblées de Commercy noyautée par les gauchistes pour imposer la parité et favoriser l’écriture inclusive en fin de mouvement((– Alors que Vanina reconnaît que l’écriture inclusive rend la lecture impossible, elle l’utilise comme rappel chaque fois qu’elle le juge nécessaire, donc en performant à son tour, un procédé qu’elle juge pourtant idéaliste. On peut être d’autant plus étonné que, si elle regrette que le néo-féminisme soit devenu le mouvement des minorités divisé en multiples minorités, alors que la révolution est une question de majorité qui n’est pas assimilable à la règle démocratique, elle utilise néanmoins un langage qui ne sera jamais repris par la majorité ou alors grand malheur à nous (cf. Orwell et la novlangue ou encore Viktor Klemperer et la « langue » du nazisme). Sans doute est-ce la manifestation d’une contre-dépendance à son « identité » féministe affirmée, mais elle reste minimaliste, ce qui fait que nous n’avons pas eu droit au point médian, ni au iel et autres catalogages.)).
Le rapport social capitaliste n’est pas formé uniquement de la contradiction capital/travail et du point de vue de sa reproduction globale, les processus d’émancipation ont perduré bien au-delà des années 1980 et particulièrement ceux qui concernent les femmes et leurs droits et ceux de nouvelles catégories (cf. le droit des enfants, le mariage pour tous ou bientôt le droit des animaux). Mais si j’emploie le terme de processus, ce n’est pas par hasard parce que cela n’est pas le fruit de « mouvements ». Mon point de vue est exprimé de façon plus dure encore par Véra Nikolsky qui souligne que cela ne plaît pas du tout aux milieux « progressistes » en général de penser que des processus impersonnels (révolution technologique, machine à laver, contraceptifs) auraient pesé bien plus lourd que les manifestations et autres cercles de parole((– Cf. Véra Nikolsky, Féminicène. Les vraies raisons de l’émancipation des femmes. Les vrais dangers qui la menace, Fayard, 2023.)).
Sur cette base retournée et dévoyée, comme le furent pas mal de propositions de la fin des années 1960 (« Il est interdit d’interdire », « Prenez vos désirs pour des réalités », « L’imagination au pouvoir »), c’est alors la boîte de Pandore qui peut s’ouvrir puisqu’on est passé de son expression libérale, au sens américain du terme, à sa réplique libérale/libertaire. Pour le sujet qui nous occupe ici, les féministes favorables à la prostitution et en soutien des « travailleuses du sexe » ont pu alors sortir de leur boîte et il en est de même pour les courants qui remettent physiquement en cause leur corps d’origine.
La critique de Vanina manque son objet parce qu’elle en devient alors une critique particulière et non générale. En effet, elle ne remonte pas jusqu’à la critique de cette affirmation de principe sur laquelle toutes les féministes sont censées être d’accord. Elle n’en dénonce que les effets pervers. Un principe dont la perte de valeur politique émancipatrice aujourd’hui ne peut que dévoiler ce qu’il a de velléitaire et d’idéaliste quand ce corps, celui des femmes comme des hommes, est de plus en plus médicalisé par les progrès de la médecine et de la chirurgie, y compris esthétique (mon corps appartient à la science, pourrait-on dire en exagérant un peu) et de plus en plus socialisé par les prises en charge de la sécurité sociale.
Ce qui distingue le capital, historiquement, c’est justement sa grande capacité d’adaptation et de transformation, qui fait que ce n’est pas un « système ». Rien ne l’empêcherait donc a priori de se passer du patriarcat. Mais pour dire cela, il faut faire la différence entre la société du capital aujourd’hui (c’est-à-dire pour Temps critiques la « société capitalisée ») et la société bourgeoise (capitaliste) antérieure. Et si l’on remonte encore plus loin dans le temps, il faut faire la différence entre capitalisme et patriarcat puisqu’en tant que « système »/institution ce patriarcat existe au moins depuis la Rome antique. Ce ne semble pas être le cas de Vanina, d’abord parce qu’elle ne voit pas le patriarcat comme un système séparé (cf. sa critique à Delphy, p. 37) et qu’elle le rattache, au moins de façon sous-entendue, au capitalisme comme quelque chose qui lui serait spécifique ; ensuite parce qu’elle me paraît confondre la division sexuée du travail reconnue comme la première forme de division du travail, dans la mesure où les anthropologues ont repéré l’universalité de la domination masculine dès les sociétés premières du fait de la place des femmes dans la reproduction (il ne s’agit donc pas d’un « système ») ; et l’institution patriarcale, par exemple quand elle parle des travailleuses du « care » (p. 258-9). S’il y a eu un « système », il a été « déconstruit » par une série de lois depuis les années 1950 (et on pourrait facilement en faire le long catalogue)… qui n’empêchent pas que perdurent des différences, des inégalités de fait, des comportements qui seront maintenant jugés sexistes à l’aune de l’évaluation de ces lois.
Parler en termes de « leurres » me semble une erreur. Les néo-féministes ne se trompent pas de cible ; certains courants affermissent et approfondissent le sillon, d’autres l’élargissent jusqu’à en brouiller la trace. Mais tous, c’est-à-dire y compris les « matérialistes », n’entretiennent qu’un rapport ténu ou même inexistant avec ce qui a été le fil rouge historique des luttes de classes, et ce non pas parce que celui-ci a été coupé par la défaite du dernier assaut révolutionnaire du tournant des années 1960/1970, mais parce qu’il n’a jamais été une référence pour les générations nées après les années 1980. Cela n’a pas empêché des révoltes et émeutes chez les « pauvres » jusqu’à même celle des Gilets jaunes, mais pour les autres, et Vanina pointe particulièrement les jeunes des nouvelles classes moyennes et je suis d’accord, ce sont même toutes ses références qui sont taxées de réactionnaires parce qu’elles s’opposent finalement à la nouvelle dynamique du capital et ce sont alors aussi non seulement les frontières de classes (comme on parlait avant) qui disparaissent ou sont occultées, mais la pertinence des notions de droite et de gauche.
Malheureusement, les leurres, aujourd’hui, ce sont ceux de l’émancipation (« par les travailleurs eux-mêmes ») quand c’est le capital qui émancipe à sa façon ; celui de l’autonomie (quand elle n’est plus « ouvrière » et que de l’autogestion on est passé à l’égogestion).
Plus généralement, ces notions, qui ont pu fonctionner comme slogans ou mantras, doivent être questionnées en dehors des sources révolutionnaires d’origine, parce qu’elles doivent être confrontées à de nouveaux questionnements, aussi bien du point de vue du rapport à la « nature intérieure » (cf. la perspective transhumaniste critiquée par Vanina et le sujet global de son livre), que du rapport à la « nature extérieure » (environnement au sens large, écologie, changement climatique). Sans jouer sur les mots, s’il faut alors s’émanciper, c’est de cette idée de toute-puissance (et de la domination qui l’accompagne) qu’on retrouve aussi bien dans les thèses classiques du capital que dans celles du marxisme. Cela ne dégage certes pas une issue de sortie à portée stratégique, de toute façon bien problématique dans le contexte actuel, mais éclaire un peu la conduite à tenir au cours des luttes quotidiennes auxquelles nous pourrons participer… ou non en fonction de cet éclairage. Une sorte de boussole a minima en quelque sorte dont il nous a fallu user au sein du mouvement des Gilets jaunes ou face aux manifestations antivax pour ne prendre que ces deux exemples ayant entraîné des positionnements variés et sujets à controverse.
JW, le 23 février 2024